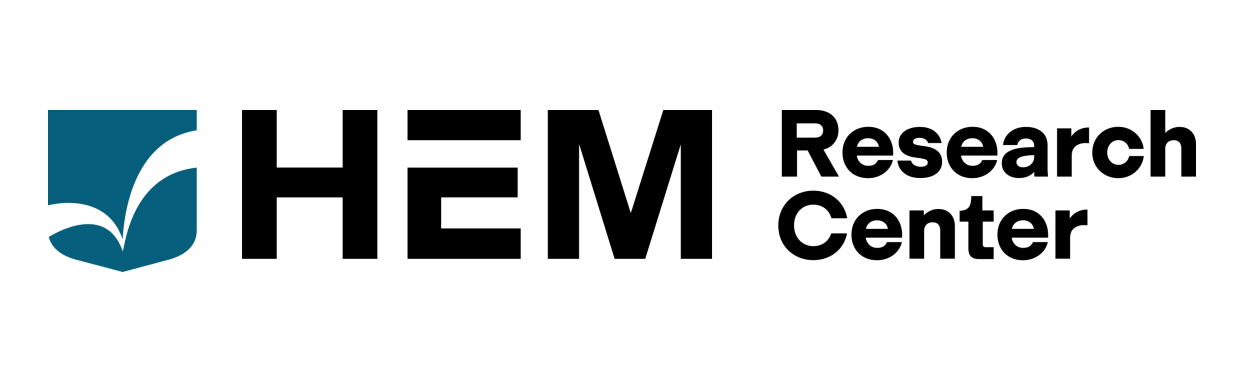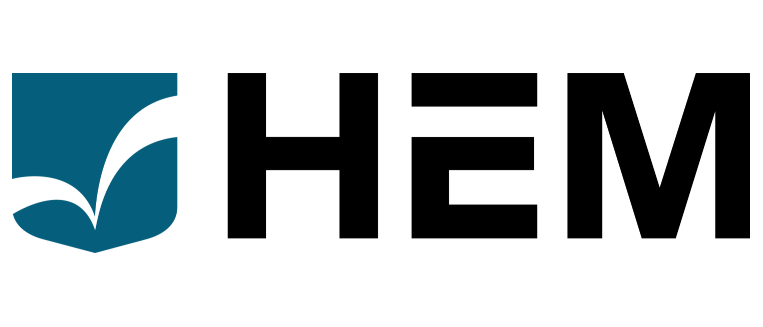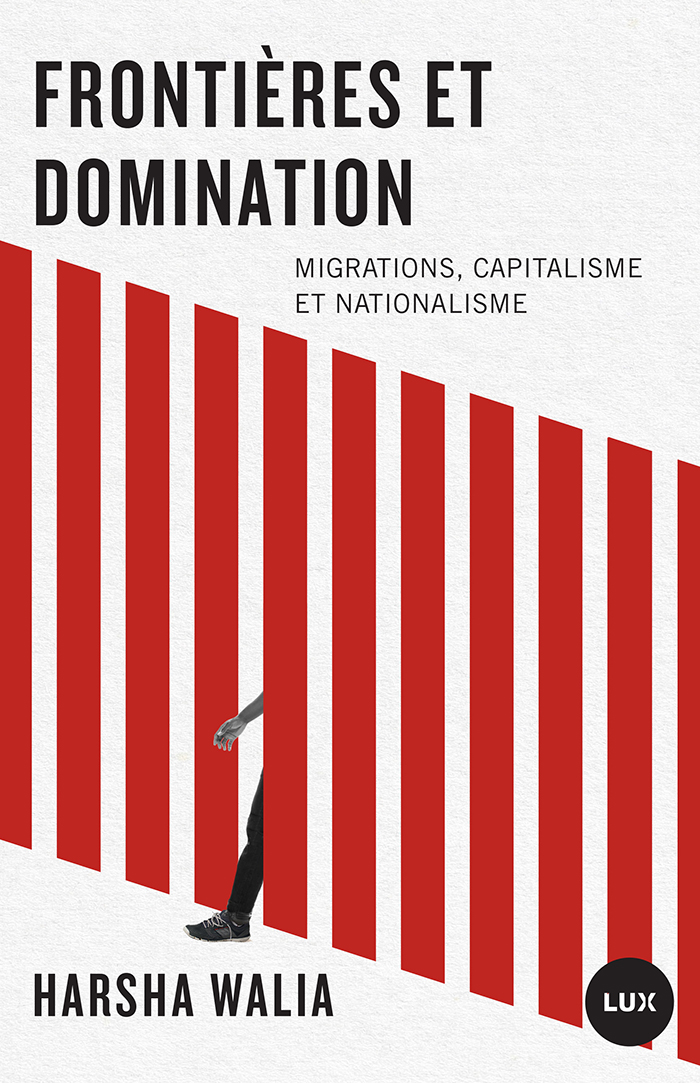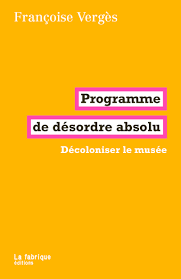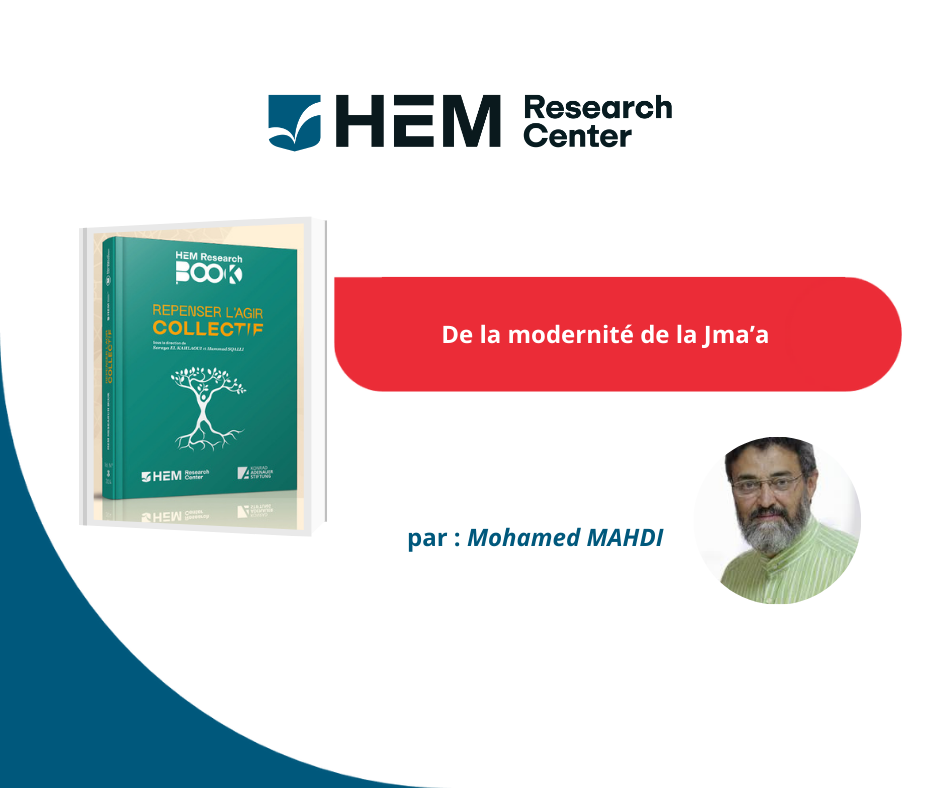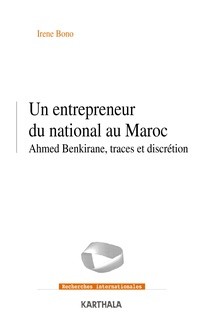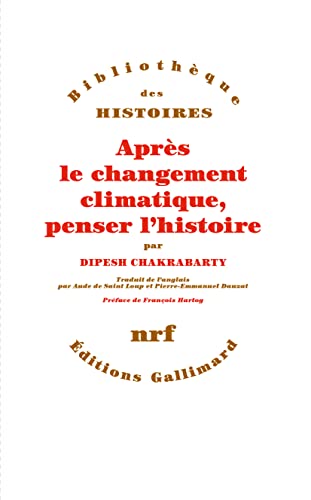

Soraya EL KAHLAOUI
Après le changement climatique, penser l’histoire
Auteur : Dipesh Chakrabarty
Pour une refonte de l’échelle du temps
Pour Dipesh Chakrabarty, le changement climatique impose de repenser le temps en reliant deux paradigmes autrefois séparés, celui du temps de la nature et celui du temps humain.
C’est une réflexion située, en réaction au changement climatique, mais qui amène Dipesh Chakrabarty à approfondir sa réflexion décoloniale dans le champ philosophique. Dans Provincialiser l’Europe, la pensée postcoloniale et la différence historique (Princeton University Press 2000 et Amsterdam, 2020, pour la traduction française), l’historien indien, professeur à l’université de Chicago et lauréat du prix Toynbee pour ses travaux, proposait de repenser les catégories construites par la modernité européenne pour saisir les sociétés et leur environnement. Dans cet ouvrage, dont on peut se réjouir qu’il ne se soit écoulé que deux ans entre sa publication en anglais et sa traduction en français, l’auteur revient sur la séparation en deux catégories du temps humain et du temps de la nature, qu’il invite à repenser ensemble. « Le globe et la planète – en tant que catégories représentant les deux récits de la globalisation et du réchauffement global – sont liés. Ce qui les rattache, ce sont les phénomènes du capitalisme (au sens large) et de la technologie modernes, tous deux d’une portée globale », indique-t-il en introduction.
La première partie du livre distingue les termes de globe et de planète, et explore les apories du capitalisme, « qui ne nous a pas offert une prise intellectuelle suffisante sur les problèmes de l’histoire humaine que le changement climatique anthropique a révélés ». Pour Dipesh Chakrabarty en effet, la planète est une « catégorie de l’histoire humaine » : si le global, au sens de colonisation de la terre par l’espèce humaine, « est une construction humanocentrique », la planète, elle, « décentre l’humain » puisqu’elle relève de considérations géophysiques bien plus larges. Prendre en compte cette dimension non humaine est nécessaire pour sortir de l’anthropomorphisme issu des catégories élaborées à partir de la Renaissance. Il s’agit non pas seulement de revenir sur le clivage entre homme et animal, mais de considérer la planète comme faisant partie du vivant – et pas seulement comme une donnée immuable, qui ne serait que la toile de fond sur laquelle agit l’humanité. D’autant que l’action de celle-ci a aujourd’hui un impact planétaire certain, qui entremêle désormais l’histoire humaine et le temps long géologique.
Sortir de l’anthropomorphisme
Dans la seconde partie, intitulée « De la difficulté d’être moderne », qui fait le lien à la modernité et réfléchit à l’articulation entre les « conceptions de la liberté des nations postcoloniales et les besoins accrus en énergie », historiquement comblés par la « maîtrise de la nature », Dipesh Chakrabarty revient sur la notion de « privilège » de l’homo sapiens, et propose de reconnaître l’agentivité non seulement des humains, telle qu’élaborée au fil des siècles par la pensée humaniste, mais aussi du vivant au sens large, animaux, Terre etc. L’enjeu est dès lors de recomposer un imaginaire et de construire des régimes politiques qui ne reposent pas sur des positions hiérarchiques. Tout un chapitre est consacré à l’analyse du suicide de Rohith Vemula en 2016, geste politique pour protester contre la marginalisation de la caste des intouchables.
Ainsi, dans la troisième partie, intitulée « Face au planétaire », Dipesh Chakrabarty propose de penser au pluriel l’anthropocène, en en soulignant le caractère multiple. Il invite à adopter « un mode de pensée centré sur la planète », ce qui a des conséquences sur notre manière de comprendre la condition humaine aujourd’hui et, à la lumière de cette nouvelle « conscience de l’époque », à réfléchir à la manière de composer de « nouveaux communs », de nouvelles solidarités qui ne peuvent être que multiples, bref, une « nouvelle anthropologie », « en quête d’une redéfinition des relations humaines avec le non-humain, y compris la planète ». Au cœur de cette réflexion, la notion de reconstruction et de réparation, face aux inégalités accentuées par l’Anthropocène.
Le livre se clôt sur un post-scriptum, une conversation avec le sociologue français Bruno Latour et conclut sur la nécessité de comprendre que l’enjeu est la survie de la civilisation et de la condition humaine, en tant qu’espèce, ce qui passe par le dépassement de « nos vues nécessairement partisanes » et de « nos vies divisées d’êtres humains ». C’est donc une « nouvelle anthropologie philosophique » à laquelle il nous invite dans ce livre très dense, qui analyse des notions aussi complexes que le développement, l’habilitabilité, la soutenabilité… Mais, au-delà de sa dimension éthique, c’est une réflexion politique extrêmement profonde qui nous est proposée.
Kenza Sefrioui
Après le changement climatique, penser l’histoire
Dipesh Chakrabarty
Gallimard, Bibliothèque des histoires, 400 p., 28 €
Frontières et domination ; migrations capitalisme et nationalisme
Auteur : Harsha Walia, traduit de l’anglais par Julien Besse
Contre l’apartheid planétaire
L’essayiste bahrainie Harsha Walia propose une redéfinition de la frontière qui n’est pas une limite géographique mais le cœur d’un système de domination.
Des frontières fermées et militarisées, un discours sur une soi-disant « crise migratoire », des discours de haine à l’encontre des personnes migrantes criminalisées…, pour Harsha Walia, ce ne sont pas des dérives illibérales. C’est le cœur même d’un système économique et politique fondé sur la domination. Pour l’essayiste et militante pour les droits des femmes, des migrants et des autochtones, née à Bahrain et installée au Canada, la frontière est un instrument de domination, au cœur du processus de formation de l’État et de son système idéologique, fondé sur la hiérarchisation des races, des classes sociales et des genres, ainsi que sur l’exploitation des humains et de l’environnement. Et, ajoute l’autrice de Démanteler les frontières (Lux, 2015) : « Un système politique et économique qui considère la terre comme une marchandise, les peuples autochtones comme un fardeau, la race comme un principe d’organisation sociale, les soins prodigués par les femmes comme un travail sans valeur, les travailleurs comme une ressource exploitable, les réfugiés climatiques comme des excédents et la planète tout entière comme une zone à sacrifier doit être démantelé. »
Dans cet essai incisif, qui s’appuie sur des exemples pris dans le monde entier, la cofondatrice de l’ONG No one is illegal revient sur le vocabulaire largement employé dans les pays du Nord pour réduire la mobilité à une « crise migratoire » et montre comment la criminalisation de la migration, le maintien des personnes migrantes dans des situations d’extrême précarité et les discours réactionnaires forment un système cohérent et profondément injuste et destructeur.
La frontière, une méthode
Le propos s’articule en quatre parties, abondamment illustrées par l’étude des pays d’Amérique du Nord, d’Europe, du Golfe et de l’Australie et de leurs politiques migratoires. Il s’appuie aussi sur les témoignages, et les travaux de journalistes et de politologues.
La première partie revient sur les concepts de « crise frontalière » et d’« invasion de migrants ». Il s’agit d’un prétexte aux « pratiques répressives de détention et d’expulsions » perpétrées par des États qui se prétendent démocratiques. Il s’agit surtout d’un retournement de la situation : « Ces formules désignent les migrants et les réfugiés comme étant la cause d’une crise imaginée à la frontière, alors qu’en réalité, la migration de masse n’est rien d’autre que le résultat des crises réelles provoquées par le capitalisme, la conquête et les changements climatiques ». Les véritables responsables sont ainsi exonérés, tandis que les victimes sont incriminées. Le discours présentant les États-Unis comme une « nation d’immigrants » est un mythe pour masquer la violence des conquêtes, des expropriations et des quotas ethniques. L’autrice insiste sur les fondements racistes et coloniaux des politiques impérialistes, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Traite des esclaves d’Afrique, accords de libre-échange, politiques d’ajustement structurel, mais aussi guerres soi-disant préventives comme en Afghanistan… sur le temps long, les moyens de déstabiliser les économies et de détruire les environnements se sont succédés, contraignant les concernés au départ. En ce sens, la question des frontières est tout sauf une affaire de politique intérieure. Or, note Harsha Walia, la Convention des Nations Unies ne retient pas les causes économiques ni climatiques pour l’obtention du statut de réfugié…
La deuxième partie se penche sur la criminalisation des migrants, qui crée un marché lucratif pour l’industrie de la sécurité et de la surveillance. Ainsi, les frontières ne marquent plus une limite territoriale mais deviennent mouvantes, à travers quatre dispositifs : l’exclusion additionne les effets de lois qui mettent les gens en situation d’illégalité, et du racisme qui construit « la figure de l’immigrant illégal » ; la dispersion territoriale se fonde sur la surveillance omniprésente qui crée la peur et pousse au départ les personnes sans papiers ; l’inclusion-marchandisation exploite la situation précaire des migrants et réfugiés pour les exploiter ; enfin le « contrôle du discours » distingue de façon arbitraires entre migrants et réfugiés. Harsha Walia décortique les mécanismes de dissuasion, d’entrave à la circulation, à la demande d’asile là où les gens le souhaitent, parfois au nom d’une soi-disant « protection des migrants », au nom bien sûr d’un ordre raciste. Elle dénonce la sous-traitance du contrôle de la migration à des pays comme le Maroc. « La sous-traitance du contrôle migratoire à des pays tiers revêt de plus en plus la forme d’une intervention impériale, révélant, au-delà du lien de cause à effet entre impérialisme et migration, comment l’externalisation du contrôle de la migration est elle-même devenue une méthode d’impérialisme contemporain. »
Dans la troisième partie, c’est la portée sociale de cette politique qui est analysée avec « la subordination juridique du statut migratoire à l’emploi » faisant des travailleurs migrants « un bassin de main-d’œuvre captive et servile » dont la « force de travail est d’abord capturée par la frontière, puis contrôlée et exploitée par l’employeur ». Ce dernier a en effet intérêt à maintenir en situation de précarité les travailleurs afin de briser toute organisation et toute revendication de classe. D’où les programmes de migration circulaire, saisonnière ou temporaire. D’où le régime de la kafala dans le Golfe. Autant de systèmes de surveillance stricte et de « ségrégation légale » de travailleurs privés de tous droits et de toute sécurité sociale, et même, dans un Canada qui se félicite de son « multiculturalisme », expulsés lorsqu’ils tombent malade. Bref, « des dispositifs de servitude cautionnés par l’État », et dont les femmes sont les premières victimes.
Enfin la dernière partie analyse les soubassements idéologiques de ce système, avec la montée des extrêmes droites aux États-Unis, en Israël, en Inde, aux Philippines ou au Brésil qui, à coup de populisme, défendent un contrôle social de plus en plus militarisé. Harsha Walia explique les leviers d’essentialisation par le libéralisme de la « différence culturelle », qui nourrit le racisme. Elle analyse la mise en fiction de la politique de la peur et de la haine et conclut : « Nous ne pouvons laisser l’État et les élites devenir les arbitres de la migration et, ce faisant, la qualifier de crise tout en se posant en victimes des migrants. »
Un brillant appel à reconsidérer le monde comme « un chez-soi comme horizon commun ».
Kenza Sefrioui
Frontières et domination ; migrations capitalisme et nationalisme
Harsha Walia, traduit de l’anglais par Julien Besse
Lux, 408 p., 23 € / 300 DH
Programme de désordre absolu, décoloniser le musée
Auteur : Françoise Vergès
Mettre fin à la dépossession
Pour Françoise Vergès, l’institution du musée est le vrai visage de l’entreprise coloniale de pillage et de ses suites.
Au début des années 2000, Françoise Vergès et Carpanin Marimoutou sont chargés de relire un projet scientifique et culturel du service de la culture de la région Réunion et la mise en place d’une agence française, avec financements européens, en vue de la construction d’un musée de la Réunion : la Maison des Civilisations et de l’Unité réunionnaise. La théoricienne féministe décoloniale et antiraciste et le professeur de littérature, éditeur et poète estiment que le projet est un calque de l’histoire de la France et ne montre pas les dynamiques et les luttes de la Réunion. Ils en imaginent un autre, traversé d’autres spatialités et temporalités, recentré sur l’Océan indien comme espace millénaire de créolisation (donc bien avant les impérialismes européens). Le projet est démantelé à l’arrivée de la droite, révélant à quel point ce champ est au carrefour de multiples enjeux décoloniaux, économiques et symboliques.
C’est à partir de cette expérience avortée que Françoise Vergès approfondit sa réflexion sur le décolonial en l’ouvrant au monde des arts et des musées. Empruntant son très beau titre aux Damnés de la terre de Frantz Fanon (« La décolonisation, qui se propose de changer l’ordre du monde, est, on le voit, un programme de désordre absolu »), elle explique : « rien d’autre ne peut mettre fin à un ordre qui est celui de l’organisation au niveau planétaire de l’oppression, de la dépossession, du racisme et de l’exploitation. Le désordre n’est pas le chaos mais la remise en cause de ce que les puissants appellent l’ordre du monde, monde qu’ils ont construit et qu’ils ne cessent de solidifier, qu’ils voudraient immuable quand bien même son organisation et son fonctionnement ne cessent d’être contestés. » Le musée universel est ainsi analysé, dans une démonstration rigoureusement argumentée, au prisme de son histoire, de son économie et des conséquences de son hégémonie.
Une arme idéologique
Le musée dit universel n’est en fait qu’un musée universel européen, inextricablement lié à l’histoire coloniale et esclavagiste. Ses collections se sont construites au fil des extorsions, dévastations et des pillages perpétrés dans les colonies, et représentent encore des « morgues illégales » pour des dizaines de milliers de restes humains privés de sépulture. Les pays du Sud global sont ainsi privés de leur patrimoine et de la possibilité de lui donner sens en écrivant leur histoire de l’art – 90 % du patrimoine africain se trouve en dehors du continent.
Le musée est aussi le reflet d’un modèle économique : celui du libéralisme, procédant dans une logique extractiviste qui atteint le déraisonnable, tant le nombre d’objets rassemblés en Europe dépasse la capacité de les exposer. Dans cette logique, il s’agit, pour figurer sur la carte mondiale, de recruter des curateurs reconnus et de présenter des collections prestigieuses. Mais les conditions de production et de fonctionnement de l’institution tolèrent les violences sexuelles, raciales et économiques. Pour Françoise Vergès, le lien doit être fait entre l’antiracisme néolibéral, le multiculturalisme pacificateur et les politiques d’austérité, car le musée est partie prenante des « dispositifs de l’État et du Capital ». Elle souligne également le fait que la conception du patrimoine est en droite ligne de celle, bourgeoise et patriarcale, de la transmission d’héritage – notamment avec l’argument « ils ne savent pas s’en occuper » avancé par ceux qui refusent la restitution des objets ou prétendent en définir les conditions.
Le musée universel est enfin une « arme idéologique », qui vise à occulter les pillages et spoliations, un retournement rhétorique pour faire passer un crime contre l’humanité comme une action de protection de son patrimoine. Ils sont un des termes du « contrat racial » exposé par Charles Mills, en ce sens que cette occultation rend possible de représenter une plantation comme un simple décor exotique, neutre, sans qu’on y voie l’esclavage comme racisme, exploitation et dépossession. Pire, ils continuent à produire du racisme structurel car ils contribuent à l’élaboration du modèle culturel qui le nourrit, avec son hétéronormativité blanche. Le lien entre ces représentations et les structures économiques est donc inextricable. Françoise Vergès témoigne de l’organisation de visites guidées au Louvre pour repérer l’esclave comme « humanité invisible » : il s’agissait, en recherchant les produits de l’esclavage qui ont bénéficié à toute la société (sucre, tabac, café, chocolat, coton…) et façonné les manières d’être, de montrer « comment ces représentations ont naturalisé l’esclavage » : « Sucre, tabac, café, coton n’étaient pas de simples produits de consommation qui avaient transformé les sociétés européennes, mais les signes d’une transformation reposant sur la déportation, la dépossession et l’extraction ». À propos de l’exposition au Musée d’Orsay à Paris sur Le modèle noir de Géricault à Matisse, Françoise Vergès intitule son chapitre : « Noir est le modèle, blanc le cadre » et relève les euphémismes dans les discours des guides, ainsi que le fait que les gardiens ont été briefés contre « toute attitude du public qui paraîtrait “menaçante”, cet élément par son absence de définition clair finissant par impliquer que le sens commun du racisme devait servir de boussole : groupe de jeunes Noir.es et racisé.es = danger ».
Dans ces conditions, l’institution n’est ni réformable ni décolonisable : il s’agit de repenser de fond en comble le musée. Que serait un musée décolonisé, un « post-musée » ? Françoise Vergès énumère de nombreuses expériences en cours, comme Decolonize This Place à New York, Black Youth Project 100… Elle cite des espaces autonomes et indépendants financièrement, comme Khiasma, Décoloniser les arts…, ainsi que les travaux de toutes celles et ceux, artistes, curateurs, etc. qui ne se limitent pas à une demande de diversité mais questionnent l’institution, proposent de nouveaux découpages, repensent un universel commun, de nouvelles formes d’organisation de l’espace, d’organisation, etc., qui ne soient pas figées. C’est en effet par l’imaginaire qu’il est possible de dépasser l’impasse contemporaine – et vu la crise climatique provoquée par le système néolibéral, c’est une urgence.
Françoise Vergès insiste sur la nécessité de maintenir à ce sujet une vigilance politique, pour refuser la récupération des luttes, leur pacification et leur effacement. Il s’agit de maintenir l’impératif de réparation, de ne pas en accepter les conditions dictées par l’ancien bourreau, et d’éviter « l’art washing ». Il s’agit aussi d’agir en concertation avec les communautés concernées, car rendre d’État à État n’est pas une garantie de savoir ce qu’elles-mêmes souhaitent faire de ces objets : cela a à voir avec le respect de la pluralité et le dépassement d’une conception unitaire et homogène de l’État-nation. Sortie d’un ordre Nord-Sud toxique, sortie des hiérarchies de genre, de classe, de race et de religions maintenues dans le musée… Bref, c’est un programme d’émancipation à tous les plans, un enjeu majeur pour toute la société.
Kenza Sefrioui
Programme de désordre absolu, décoloniser le musée
Françoise Vergès
La Fabrique, 256 p., 15 €

Mohamed Mahdi
Anthropologue marocain. La publication de sa thèse, Pasteurs de l'Atlas. Production pastorale, droit et rituel, soutenue en 1993 et publiée en 1999 (Casablanca, Fondation Konrad Adenauer) est un événement qui a contribué à l'affirmation de la nouvelle anthropologie marocaine....
Voir l'auteur ...De la modernitéde la Jma’a
L’article de l’anthropologue, Mohamed Mahdi, « modernité de la Jma’a» interroge la relation particulière, faite de ruptures et de continuités, que les communautés entretiennent avec la tradition. C’est là une des acceptions du concept de modernité. L’article postule que la Jma’a existe et existera tant qu’existent des communautés qui partagent des intérêts matériels et spirituels, et revendiquent une identité commune pour s’affirmer et donner sens à leurs vies.
Un entrepreneur du national. Ahmed Benkirane, traces et discrétions
Auteur : Irene Bono
Portrait d’un entrepreneur discret
La politiste italienne Irene Bono apporte, à travers le parcours d’Ahmed Benkirane, un éclairage important sur l’articulation entre construction de la nation et expériences individuelles.
« Ce qui fait changer la nation, ce sont les transformations des manières dont des liens sociaux étroits se créent entre les acteurs, et des raisons qui incitent les acteurs à se sentir appartenir au même groupe et, ainsi, à légitimer l’ordre social sous-jacent à celui-ci », affirme Irene Bono. Dans ce livre, le premier qu’elle signe seule, après deux ouvrages avec Béatrice Hibou et Mohamed Tozy, la professeure de sciences politiques à l’université de Turin approfondit ses travaux sur la notion de participation politique. Dans Un entrepreneur du national au Maroc, c’est le fruit de quinze ans de recherches qu’elle présente. Consciente de la nécessité de ne pas limiter le récit de la construction nationale à ses grandes figures héroïques mais de l’aborder à travers une multiplicité d’expériences personnelles et d’y inclure une dimension sensible, intime, elle étudie le parcours d’un homme d’affaires qui eut aussi un rôle au gouvernement, Ahmed Benkirane. Ahmed Benkirane, né en 1927 à Marrakech, est loin d’être un anonyme inconnu : négociant en huiles, fondateur de Maroc informations, il a été secrétaire d’État au Commerce dans le gouvernement Balafrej, a dirigé la SAMIR, la Caisse de dépôts et de gestion (CDG) puis l’Office de commercialisation et d’exportation. Il a été député, vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Sa trajectoire a interpelé la chercheuse en ce qu’elle permettait d’appréhender l’initiative économique et les modalités de « l’agir politique » pendant les années de plomb.
Irene Bono retrace donc ce parcours à partir du dépouillement des archives privées d’Ahmed Benkirane et de nombreux entretiens, avec lui-même et d’autres personnes. Ce livre extrêmement bien documenté se prolonge dans un site, Du livre à l’archive, auquel on accède par des QR Codes présentés en annexe, et qui présente les photos et les documents auquel il est fait référence. C’est que l’ouvrage s’inscrit dans le fil de l’école historique de la microstoria : il s’agit d’étendre le champ des sources jugées légitimes pour documenter une période. C’est également une « expérience épistémologique », car elle ne se réduit pas à un « témoignage biographique » : Ahmed Benkirane a en effet relu, discuté le texte, et l’a complété par des témoignages de sa main. Du reste, le livre ne retrace pas l’ensemble de son parcours, mais se focalise sur ses années de formation jusqu’à la fin de l’État d’exception. Ce récit, où l’intéressé apparaît sous le nom d’« Abk » – abréviation qui ne m’a pas semblé indispensable, même si elle est justifiée par la volonté d’en faire un personnage – est surtout le point de départ pour étudier un concept : celui de la discrétion « comme force politique au cœur des relations de pouvoir ». La force de ce travail réside dans la richesse conceptuelle : Irene Bono aborde chaque élément avec une grande finesse, en faisant état de l’abondante littérature en histoire, histoire de la presse, recherches économiques et politiques etc., qu’elle aborde pour y apporter de nouveaux éléments, de nouvelles nuances. Il s’agit également d’un récit incarné, où la réflexion prend pour point de départ, dans chaque chapitre, un objet significatif.
Éloge de la discrétion
Dans la première partie, « Sauver la biographie de la nation », c’est le passeport obtenu en 1954 qui est le fil conducteur pour comprendre les discrètes expériences du politique. Comment obtenir un passeport quand on est militant pour l’indépendance ? L’autrice analyse les espaces de partage et d’action. « À l’époque de son passeport de 1954, non seulement Abk vivait à cheval entre différents mondes sociaux, mais il avait aussi et surtout un profil difficile à déterminer à l’aune des canons de cette période : son activité politique était connue mais son profil était celui d’un révolté aux yeux des autorités, d’un célibataire qui devait se remettre sur le droit chemin aux yeux de sa famille, d’un fêtard aux yeux de la bonne bourgeoisie de Casablanca, d’un fils de bourgeois aux yeux de ses voisins du boulevard de Suez, d’un commerçant aux yeux de ses interlocuteurs en France, d’un jeune fasciné par le communisme aux yeux des militants nationalistes exilés ou en prison. » Cette multiplicité de facettes est vectrice de discrétion : « elle n’était pas discrète dans le sens où elle se caractérisait par sa circonspection, mais plutôt dans le sens où elle était relativement insoupçonnable aux yeux des acteurs sociaux qui ne partageaient pas les mêmes expériences que lui. » Le passeport, ajoute l’autrice, montre également la porosité entre l’avant et l’après-indépendance, obligeant à « “archiver ensemble” deux séquences historiques qui sont souvent pensées comme séparées » et permettant de reconsidérer la valeur de la date : en faire un événement permet d’y réintégrer les récits individuels, donc la complexité.
La seconde partie retrace, à partir de sa licence de sport du collège Sidi Mohammed de Marrakech, les différentes générations politiques au sein du mouvement national, et la socialisation au nationalisme, via l’institution Guessous, les études à Paris et le foyer de la rue Serpente. Irene Bono s’intéresse ici aux conflits de mémoire, révélateurs des différentes manières de comprendre la nation et ce qu’est un nationaliste. Dans « Définir l’indépendance », elle se penche sur la photo d’une réception accordée par Mohammed V à l’équipe du ministère du Commerce où Ahmed Benkirane est directeur de cabinet, pour étudier « le caractère mouvant des lieux de gouvernement » et les multiples espaces où se déploient les enjeux de pouvoir hors des institutions : syndicat, groupes de réflexion économique, clubs d’affaires, cercles intellectuels… Elle souligne les convergences pragmatiques plus qu’idéologiques, analyse les tribunes de presse comme lieu d’encadrement du conflit politique, et conclut : « Ce qui fait la discrétion de l’action de gouvernement est le fait qu’un acteur précis, doté de compétences spécifiques et inséré dans une configuration de rapports de force donnée, est capable de “faire lieu” de gouvernement, c’est-à-dire d’engendrer des effets de levier, quelle que soit la position qu’il occupe, pour promouvoir l’action de gouvernement que les circonstances exigent, compte-tenu des contraintes du contexte, en s’appuyant sur les moyens qu’il parvient à activer. »
Irene Bono aborde ensuite la « Participation politique et souveraineté nationale », après le « choc » de la scission de l’Istiqlal pour Ahmed Benkirane qui était proche de Mehdi Ben Barka et de Abderrahim Bouabid, et elle s’intéresse aux effets de la scission sur le milieu des affaires. Dans « Façonner le champ politique », elle étudie l’expérience de Maroc Informations, souvent mentionnée comme une brève expérience de presse non partisane et censurée : que signifie s’investir dans le jeu politique à travers une affaire de presse ? Elle porte une attention particulière à la rubrique économique comme lieu d’expression des clivages politiques, à une époque où l’enjeu majeur est les modalités d’affirmation de la marocanisation de l’économie nationale. Enfin, dans « Familiarité, étrangeté et frontières du national », elle se penche sur la souveraineté économique « comme champ de bataille » autonome. Irene Bono relève le peu d’attention, dans la littérature économique, à la transformation du rôle des acteurs, notamment étrangers. Cette notion d’étrangeté, c’est sous l’angle de la familiarité des pratiques et de l’appartenance qu’elle l’aborde pour montrer les accommodements entre autonomie financière et opposition politique. Elle s’intéresse ici aux lieux de loisirs, clubs de golf, Club des Clubs de Casablanca (CCC) offrant la possibilité de relations informelles, à la politique des cadeaux, à la « violence discrète » des affaires et des relations d’argent.
Au final, ce livre remarquable brosse un portrait du capitalisme marocain et des transformations de la société dans la durée à travers les relations personnelles, l’intime, le voisinage, ce qui reste aux marges de la sphère publique et ne rentre pas dans les cadres d’analyse classique.
Kenza Sefrioui
Un entrepreneur du national. Ahmed Benkirane, traces et discrétions
Irene Bono
Karthala, collection Recherches inter