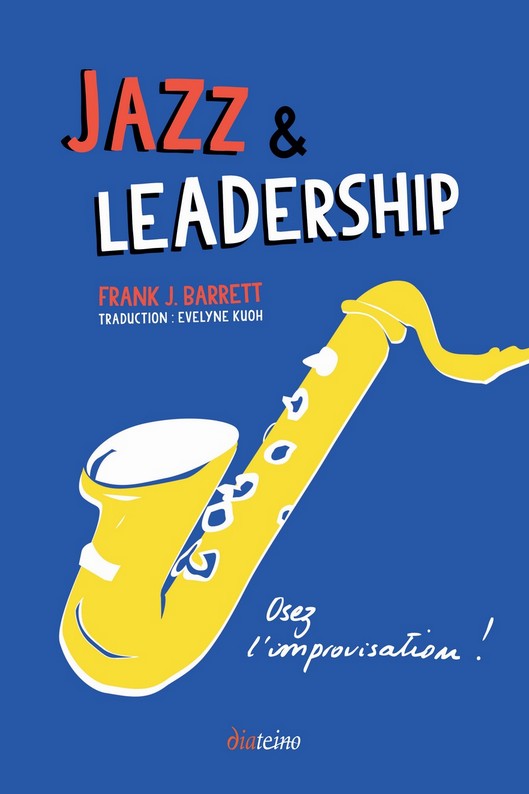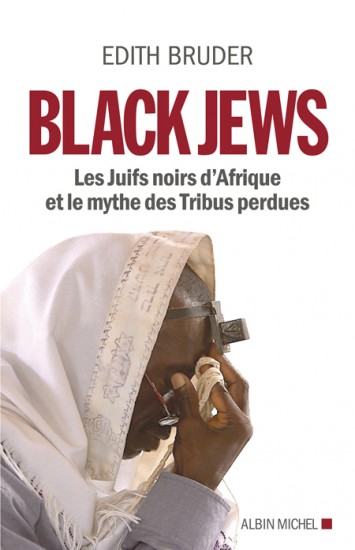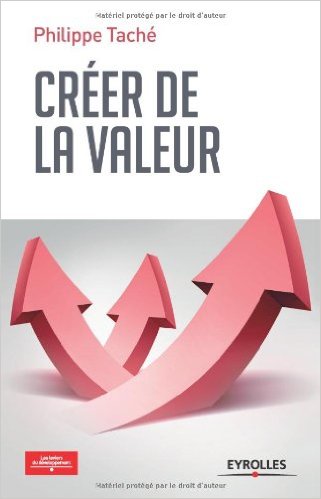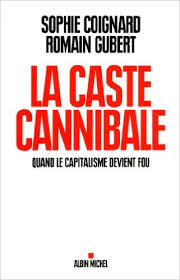Le Coran bien loin du dogme et tout prêt de la raison et de la réflexion
Auteur : Mahmoud Hussein
Après Al-Sîra, (le Prophète de l'Islam raconté par ses compagnons -Grasset -2005 -2007) et Penser le Coran, parus chez le même éditeur en 2009, Bahgat El Nadi et Adel Rifaat, alias, Mahmoud Hussein, reviennent avec un nouvel essai : Ce que le Coran ne dit pas.
Un titre qui interpelle, irrite certains et affranchit d’autres.
Le livre s’ouvre ainsi : « Lire le Coran. L’aborder d’un œil vierge. Le découvrir par soi-même. L’explorer au fil de sa liberté ». De prime abord, les Mahmoud Hussein nous préviennent : Il va falloir penser, se défaire de tout ce que l’on sait, renoncer à nos repères habituels et tout ce qu’on a appris par ailleurs ! En contrepartie, ils nous offrent des horizons plus larges, ouvrent de nouvelles voies et proposent d’aller au fond des choses. Refusant tout enfermement de la religion musulmane dans une lecture littéraire qui ne reconnaît ni le temps ni l’espace, les essayistes nous présentent une lecture libératrice !
Un petit livre (110 pages) très riche, dense, foisonnant d’informations et d’explications. Les deux auteurs, amis et complices dans la vie, d’origine égyptienne vivant à Paris depuis quelques années, ont appuyé des lignes qu’ils avaient déjà tracées dans Penser le Coran. Avec ce nouvel essai, ils nous proposent d’aller aux origines de la Révélation. Ils nous conduisent vers un chemin spirituel loin du dogme, nous engagent dans un procédé de réflexion. Là où tout un chacun devient acteur de sa destinée, et maître de ses croyances. Les Mahmoud Hussein nous restituent cette liberté de penser propre à la religion musulmane et qui a longtemps été occultée. A travers cette nouvelle lecture (voie), « Le croyant découvre ainsi qu’il n’est pas tenu de suivre telles quelles les prescriptions que Dieu a destinées à une période désormais révolue. Il retrouve sa liberté intérieure. Et avec sa conscience, entre les versets qui l’obligent et ceux qui ne le concernent plus».
Liberté, libre-arbitre, Ce que le coran ne dit pas est jonché de ces paroles libératrices. Mais si tel est le message de la Parole Divine, pourquoi sommes-nous arrivés aujourd’hui à un tel enfermement ?
Pour comprendre la situation actuelle, il faut suivre les auteurs aux sources du clivage, à ce débat vieux de plusieurs siècles, qui consiste en l’opposition entre les conformistes et les rationalistes. Pour les premiers « l’homme est dépourvu de la capacité de créer des actes » pour les seconds, Dieu a doué les hommes « d’une capacité de jugement rationnel et d’une puissance créatrice, nommée qudra, en vertu de laquelle ils peuvent produire des actes libres. Le libre-arbitre humain ne s’oppose pas à la toute-puissance divine ». Contre les Mu’tazilites (rationalistes), se dresseront Ibn Hanbal et al-Ash’arï, en gardiens de la Tradition et c’est leur lecture de la religion qui l’emportera pendant des siècles.
Le caractère immuable du Coran est ainsi décrété. Il règnera sur le monde musulman pendant de longs siècles.
Une religion où l’intelligence est possible
Ceux qui connaissent les Mahmoud Hussein remarqueront l’évolution de leur écriture. Dans, Ce que le Coran ne dit pas, ils creusent davantage de sillons pour aller à l’essentiel. Les auteurs ont trouvé outil et matière autant dans le coran que dans la vie du prophète sur laquelle ils se sont penchés pendant de longues années. Ils nous livrent le résultat de leurs recherches et l’énoncent clairement en trois constats.
Premier constat : « la parole de Dieu ne se confond pas avec Lui. Dieu est éternel, mais Sa parole épouse souvent les préoccupations d’une époque historique déterminée, celle de l’Arabie du VIIème siècle, en se référent à des personnes, à des événements, à des problèmes, inscrits dans le temps terrestre ».
Ils confortent ainsi la thèse du Coran « créé ». Pour cela, ils s’appuient sur des versets coraniques, se réfèrent à l’histoire même de la Révélation qui a pris 22 ans. « Les incroyants ont dit : Si seulement le Coran avait été révélé d’une seule traite ! Nous l’avons ainsi révélé pour que ton cœur en soi affermi. Et nous l’avons scandé mot à mot ». XXV 32.
Selon Les Mahmoud Hussein ce verset est la preuve même du caractère évolutif du Coran. Dans ce chapitre, d’autres exemples viennent étayer cette thèse.
Deuxième constat : « La parole de Dieu ne « descend » pas sous forme de monologue, mais sous forme d’un dialogue entre ciel et terre ». Nous entrons alors dans l’Arabie du 7ème siècle et les préoccupations du moment. Dans ce chapitre, les auteurs reviennent sur les circonstances de la révélation, le contexte de l’époque pour resituer certains versets à leur juste valeur. Toute l’organisation sociale de l’Islam s’inscrit dans le circonstanciel. Cela ne veut absolument pas dire que les versets qui s’y affairent sont à renier. Mais seulement à placer dans leur contexte, qu’ils nous servent d’exemple dans leur esprit et essence « Le croyant peut toujours y trouver une leçon à méditer, une inspiration à suivre, une réflexion à déployer », précisent les auteurs.
Troisième constat : « Dieu n’a pas donné à tous les moments de Sa Parole la même portée. Il prononce des vérités d’ordres différents, entrelaçant l’absolu et le relatif, le perpétuel et le circonstanciel. Un grand nombre de versets revêtent une portée qui déborde le cadre temporel où ils ont été révélés, qui touche au fondements spirituels, métaphysiques, eschatologiques de l’Islam ».
Aussi, la question des versets abrogés y est relevée pour dire l’aspect évolutif du message divin, le situant ainsi dans l’espace et le temps.
Les essayistes nous transportent vers un autre niveau de compréhension, là où chacun est autorisé à utiliser son intellect pour trouver sa voie, là où la raison et la réflexion l’emportent, là où les mots ne sont pas dépourvus de leurs sens cachés, là où l’intelligence est possible.
Prendre acte, c’est ainsi qu’on pourrait résumer cet essai plein d’amour, précis sans lourdeur et fluide sans légèreté.
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Ce que le Coran ne dit pas
Mahmoud Hussein
Grasset
110 pages
9 euros
10 scénarios catastrophes pour sauver la planète
Auteur : Alain Grousset
Alain Grousset nous livre des fictions documentaires pour nous alerter des dangers imminents qui guettent la planète. Un florilège de textes, doux-amers, regroupant 10 auteurs qui nous racontent dix histoires effrayantes dans une très belle écriture.
Glaciation, inondations, pollution, guerre atomique, disparition de la faune et de la flore, manipulations génétiques, guerre avec les machines, guerre avec les insectes…sont autant de thématiques abordées dans ce recueil de nouvelles, sous le titre : 10 façons d’assassiner la planète, comme 10 recettes faciles à exécuter pour en finir au plus vite avec la terre. Des focus si proches de la réalité et de la caricature qu’on se demande comment est-ce possible ? Alain Grousset, responsable des littératures de l’imaginaire dans le magazine Lire, a joué le rôle d’anthologiste et nous propose une fiction basée sur des prévisions bien réelles. « En explorant dix possibles souvent très noirs, les dix grands auteurs de cette anthologie ont tous la volonté d’attirer l’attention sur ce qui risque à coup sûr d’arriver si l’on ne réagit pas dès aujourd’hui », avertit l’anthologiste.
Comme nous le savons tous, la science fiction s’accommode si bien des scénarios apocalyptiques et catastrophiques. Mais l’anticipation nous donne à voir davantage la réalité et le présent, qui du coup, paraissent si grossiers.
Lee Hoffman le célèbre auteur de science fiction nous prête quelques réflexions à propos de la surpopulation de la terre. Tandis que Christophe Lambert choisit l’humour pour nous parler de la disparition de la faune et la flore. Une lecture à faire de préférence en dégustant une salade bien croquante, avertit Grousset ! Le héros de cette nouvelle est visité par un homme qui vient du XXIIème siècle «d’où je viens, explique le visiteur, la nature n’est plus qu’un souvenir lointain...(…) on a bien essayé de faire pousser des arbres, des légumes et des fleurs dans des serres, à l’abri des poisons sécrétés par l’industrie et la circulation, mais un virus a terminé ce que l’homme avait commencé. La dernière plante, une marguerite pourtant très résistante, est morte le 18 janvier 2167. Ce fut un jour de deuil mondial ».
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! », disait le petit prince de Saint-Exupéry. La disparition de la dernière fleur de la planète en est la démonstration.
Disparition de fleurs, d’animaux… mais aussi inondations. Le jour où la planète se mettrait à pleurer, nous dit poétiquement Grousset, ce jour-là, même Noé ne pourra y échapper !
Aquella de Donald A. Wolheim, nous raconte ce désastre. Cette nouvelle a la particularité d’avoir été écrite par le célèbre auteur de science fiction en 1942. Une histoire qui fait sourire malgré tout, lorsqu’on apprend que la planète Aquella s’appelait : La terre, il y a bien longtemps !
Chez Robert Bloch, Le jour se lève. Dans cette nouvelle proche de la fin du monde où la bombe atomique a tout détruit, l’auteur reste contemplatif et s’interdit tout propos moralisateur. Le narrateur raconte seulement ce qu’il voit dans des descriptions détachées et sans état d’âme, comme pour dire que même chez ce survivant, la mort s’est bien introduite, excluant toute émotion «dans un sous-sol, un studio d’artiste ouvert en plein ciel ; ses murs étaient encore intacts et couverts de toiles abstraites. Au centre de la pièce se dressait un chevalet, mais l’artiste avait disparu. Ce qui restait de lui était étalé en une masse dégoulinante sur le tableau, comme si l’artiste avait réussi à mettre quelque chose de lui-même dans la peinture ». Si la science-fiction aime les catastrophes, notre réalité semble bien s’en accommoder. Les OGM sont déjà dans nos assiettes et on n’a pas fini de découvrir leurs effets néfastes sur nos corps et leur impact sur la faune et la flore. Allons vers le futur alors pour voir un peu ce qui s’y passe. On lit cette nouvelle, comme on regarderait à travers une serrure, l’air effrayé. Pourtant, ces fictions sont aussi, autant de scénarios que l’on pourrait encore éviter. La science-fiction engagée est aujourd’hui un outil dont on peut se servir pour réaliser nos contradictions.
La guerre avec les insectes est la plus récente nouvelle, très douloureuse car tellement imminente. On se sent si proche du gouffre en lisant la projection, Le sacrifié de Philip K. Dick. Grousset s’amuse à nous introduire chaque thématique par des commentaires dont la gravité n’empêche pas l’humour et la légèreté. « Les insectes s’adaptent à l’environnement humain, ironise-t-il, Les cafards adorent nos cuisines ! Dès qu’un nouvel insecticide est trouvé, les insectes mutent aussitôt et deviennent encore plus résistants. Ils sont patients, ils savent que nous ne sommes qu’une parenthèse dans leur longue histoire. Chaque jour, ils gagnent un peu de terrain : une nouvelle maison infectée de termites par-ci, l’agrandissement d’une fourmilière par-là, les insectes nous tolèrent pour l’instant ! »
A la fin de cette lecture, on finit par se demander si avant tout, l’homme ne serait-il pas en guerre contre lui-même ? Pour les amoureux de la science-fiction ce livre est un petit bijou, pour les écolos, il est un outil de travail, pour ceux qui ne seraient pas encore conscients du danger, c’est une source d’information très riche. Il y a à boire et à manger dans ces dix façons d’assassiner notre planète. N’hésitez pas, tant que c’est encore possible !
Par : Amira Géhanne Khalfallah
10 façons d’assassiner la planète
Alain Grousset
Flammarion
142 pages
94 DH
Houellebecq et la pensée économique
Auteur : Bernard Maris
L’économiste Bernard Maris propose une lecture de l’œuvre de Michel Houellebecq en soulignant la dénonciation qu’il fait du capitalisme.
« Aucun écrivain n’est arrivé à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque comme lui », s’enthousiasme l’économiste et journaliste français Bernard Maris à propos du romancier Michel Houellebecq. Compétition, destruction créatrice, productivité, travail parasitaire versus travail utile, argent… tous ces thèmes sont présents dans son œuvre, depuis son essai sur Lovecraft (Le Rocher, 1991), jusqu’à La Carte et le territoire (Flammarion, 2010), couronné du prix Goncourt. « Extension du domaine de la lutte parlait du libéralisme et de la compétition, Les Particules élémentaires du règne de l’individualisme absolu et du consumérisme, Plateforme de l’utile et de l’inutile et de l’offre et de la demande de sexe, La Possibilité d’une île de la société post-capitaliste ayant réalisé le fantasme des « kids définitifs » que sont les consommateurs, la vie éternelle. Et chaque roman reprenait le refrain des autres : la compétition perverse, la servitude volontaire, la peur, l’envie, le progrès, la solitude, l’obsolescence, etc., etc. » Mieux, souligne l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation en économie, dont le très piquant Antimanuel d’économie (Bréal, 2003), Houellebecq fait référence à de nombreux penseurs de l’économie : Fourier, Proudhon, Orwell, William Morris… Bernard Maris relève notamment cinq grands économistes dont les idées phares sont en dialogue avec cette œuvre littéraire comparée à Balzac pour son réalisme et à Céline pour sa noirceur.
D’abord Alfred Marshall (1842-1924), penseur de la question de la valeur économique et de la loi de l’offre et de la demande. Houellebecq, lui, y voit le triomphe absolu des individus et l’effritement de la société en une infinité de « particules élémentaires » flottant, en l’absence de corps intermédiaires, dans un « univers de transactions généralisées » qui débouche sur un cauchemar : « le bonheur quantifiable ». Le héros de La Carte et le territoire, Jed, étend cette réflexion sur la loi de l’offre et de la demande à la production artistique : « Jed connaît sa valeur de marché. Mais ce qu’il vaut vraiment, il l’ignore », note Bernard Maris. Houellebecq ne cesse de condamner dans le capitalisme cet « état de guerre permanente » (Plateforme) et déplore que la société occidentale repose sur le fait d’« augmenter les désirs jusqu’à l’insoutenable tout en rendant leur réalisation de plus en plus inaccessible » (La Possibilité d’une île).
« Darwinisme social »
Joseph Schumpeter (1883-1950) voyait dans l’innovation et le progrès technique les moteurs de l’économie. Houellebecq pointe le « terrorisme de l’obsolescence » programmée des marchandises. Ses personnages sont souvent des cadres dont la « fonction unique » (La Poursuite du bonheur) est de consommer. « L’entreprise est le royaume de l’asservi volontaire, explique Bernard Maris. Le cadre n’a pas le pouvoir. Il est condamné à servir son maître pour maintenir un niveau de salaire destiné à satisfaire son unique moteur, la consommation ». D’où des pages terribles sur la « rivalité mimétique » de cadres à l’insatiable « soif de pacotilles ». Tel est le « domaine de la lutte ». Quant à l’innovation, elle est un outil de déstabilisation et d’asservissement par la peur, puisqu’« il s’agit le plus souvent de démoder aux yeux du public des objets auxquels il aurait le tort de s’habituer, et auprès desquels il acquerrait une certaine sécurité ». Les seuls personnages positifs ceux qui « ne réagissent pas mécaniquement aux stimuli de l’argent – bref, les anti-homo-oeconomicus », conclut Bernard Maris.
Avec John Maynard Keynes (1983-1946), Houellebecq met en cause « cet aspect infantile, puéril du capitalisme et de la société de consommation (l’impossibilité de s’arrêter, d’être saturé, de ne pas en demander plus) ». Agitation tragique, s’il en est, insiste Bernard Maris : « Pourquoi les hommes s’agitent-ils, sinon pour ne pas voir ce qui les attend, la maladie et la mort ? […] La consommation perpétuelle n’est-elle pas la forme suprême du divertissement pascalien ? » Tablettes, consoles, Smarphones…, « le monde moderne est un monde de jouets » où, sous l’injonction de la publicité, l’homme s’abîme solitaire, oublieux de liens collectifs qui dérangent un marché « abolissant tout lien autre que monétaire ». Dans ce système, la culture n’est tolérée qu’en tant que moment de pause évitant « la suffocation dans le travail et la consommation ».
Karl Marx (1818-1883) et Charles Fourier (1772-1837) réfléchissaient à la dignité des travailleurs, Houellebecq s’interroge sur l’utilité du travail produit. « Les ouvriers, les techniciens ont son respect », note Bernard Maris. « Les autres – commerciaux, publicitaires, stylistes, cadres administratifs privés ou publics – sont simplement des « parasites » ». En effet, « ce n’est pas parce que l’on fait de l’argent que l’on crée de la richesse ». Les romans de Houellebecq décortiquent les mécanismes de domination et d’asservissement à l’œuvre sur le marché du travail. Ils déplorent la césure étanche entre les deux parties de la vie humaine, entre son travail et le temps où il reconstitue sa force de travail – Marx rêvait, rappelle Bernard Maris, d’une société abolissant la distinction entre travail manuel et travail intellectuel.
Enfin Thomas Malthus (1766-1834), témoin de la dureté de la condition ouvrière, développait une thèse sur l’élimination « naturelle » des pauvres. Michel Houellebecq, lui, peuple ses romans d’êtres faibles « que la nature se chargera d’éliminer ». « Le thème du suicide occidental au terme du capitalisme » est, selon Bernard Maris, un leitmotiv de cette œuvre, où une happy end est réservée aux happy few. Pour les autres, c’est la misère affective et sexuelle (Plateforme). « A la baisse tendancielle du taux de profit, ajoute Michel Houellebecq, correspond la baisse tendancielle du taux de désir : cette société ne sait plus comment attiser le désir, exciter les sens ». Dans La Possibilité d’une île, Michel Houellebecq écrivait : « Toute civilisation pouvait se juger au sort qu’elle réservait aux plus faibles ». Une lecture stimulante pour relire un écrivain majeur.
Par : Kenza Sefrioui
Houellebcq économiste
Bernard Maris
Flammarion, 160 p., 14 €
Management : osez le jazz !
Auteur : Frank J. Barrett, traduit de l’anglais par Evelyne Kuoh
Le jazz repose sur une forme d’organisation souple, ouverte et responsable qui peut être un modèle pour les entreprises innovantes.
Miles Davis, Duke Ellington, Sonny Rollins... Ces géants du jazz sont rarement cités dans les travaux sur l’entreprise et le management. Pour Frank J. Barrett, c’est un tort. Ce professeur en management et en comportement organisationnel en Californie est aussi pianiste de jazz. Et c’est avec sa sensibilité de musicien qu’il pense les questions de développement humain et organisationnel. Son livre naît du constat largement partagé que le monde du travail a changé. Au XXème siècle, l’organisation se faisait de façon rigoureuse. Aujourd’hui, il faut « accroître notre vision du leadership au-delà de ces modèles hiérarchiques, afin de mieux apprécier le pouvoir du relationnel ». Au XXIème siècle, « l’accent doit être mis sur les équipes plutôt que sur les individus, et l’on devrait encourager l’apprentissage et l’innovation en continu plutôt que le respect de plans préétablis ». Pour éclairer le monde de l’entreprise, l’auteur s’inspire d’exemples tirés du monde du jazz. Il entend ainsi « montrer comment certains de ces principes sont déjà mis en pratique dans de nombreuses entreprises ».
Premier principe : « bousculer les routines, maîtriser l’art de désapprendre ». Dans un environnement « de plus en plus chaotique et turbulent », les modèles de commandement et de contrôle sont dépassés et le management doit évoluer de l’art de la planification à celui de l’improvisation. Face aux crises, il faut savoir abandonner les routines pour répondre dans l’instant et « une trop grande confiance dans les schémas appris (pensée familière ou automatique) a tendance à limiter la prise de risque nécessaire au développement du génie créatif, de la même manière que trop de règles et de contrôles freinent l’interaction des idées ». Mais, précise Frank J. Barrett, improviser n’est pas le fait de génies autodidactes, c’est « un art très complexe, le résultat d’un apprentissage implacable et d’une imagination domptée », supposant des années de pratique et d’imprégnation de schémas.
Deuxième principe : « oser le chaos, dire oui à l’inconnu ». « Bien que les musiciens de jazz soient surtout connus pour leurs solos, le jazz est en définitive un processus permanent d’intégration par le groupe », insiste Frank J. Barrett : le dialogue et les échanges sont permanents et reposent sur le fait que « les musiciens se disent implicitement « oui » », acceptent le jeu du bricolage, se mettent dans un « état de totale réceptivité ». De même, un manager doit pouvoir « imaginer, suspendre le doute et faire un saut dans l’action, même s’il ne sait pas où ses choix vont le mener ».
Briser les carcans
Troisième principe : « expérimenter dans l’action, transformer les erreurs en apprentissages ». La logique est ici une « esthétique de l’imperfection », reposant sur « le courage de l’effort » et la « culture de l’erreur constructive ». Il s’agit de créer une « zone psychologique de confort » où les individus se sentent libres d’expérimenter pour apprendre, de prendre des risques en zone de sécurité, de s’engager dans l’action mais aussi d’évoquer leurs erreurs et d’y réfléchir.
Quatrième principe : « équilibrer liberté et contraintes, une structure minimale pour une autonomie maximale ». Le mot clef est ici « autonomie sous contrôle ». Les orchestres de jazz sont des systèmes « chaordiques », combinant ordre et chaos, créant « des carrefours de décision pour éviter de se laisser gouverner par des règles stériles, tout en optimisant la diversité [et] encourageant l’exploration et l’expérimentation ». Les organisations innovantes aussi. Comme dans les systèmes complexes décrits par les sciences physiques et la biologie, qu’une pensée linéaire ne peut appréhender et où l’action émerge en situation de déséquilibre, et non d’ordre, il faut donc une normalisation minimale pour garantir l’équilibre entre autonomie et interdépendance. Au modèle classique des trois R (Règle, Rôle, Responsabilité), Frank J. Barrett préfère celui de l’auto-organisation soutenue par des liens souples et non étouffants, adopté par les communautés comme Wikipédia.
Cinquième principe : « improviser, partager les expériences ». Dans les jam sessions, « on apprend en faisant », en jouant, au hasard. Il faut reconnaître la richesse des pratiques, au-delà des fiches de postes conventionnelles, multiplier les collaborations selon le processus du crowdsourcing, comme l’a fait Linux, car « les grandes idées sont souvent générées dans des environnements favorables à la convivialité et à l’échange. »
Sixième principe : « le véritable accompagnement, alterner followership et leadership ». Au PDG rock star, considéré comme le créateur de la richesse de l’entreprise, le jazz oppose le leadership tournant et l’art du comping, reposant sur l’écoute généreuse, véritable source de créativité. Dans les entreprises, plaide Frank J. Barrett, « l’accompagnement – le fait d’aider les autres à réfléchir tout haut et à exprimer le meilleur d’eux-mêmes – devrait être un art plus souvent reconnu et récompensé », car il suppose de savoir défendre sa position en même temps que donner aux autres l’espace pour expérimenter.
Septième principe : « l’art de provoquer, insuffler l’envie de se dépasser ». Il s’agit d’encourager un état d’esprit créatif, en considérant que le confort de la compétence peut devenir un piège et en cultivant la réactivité et le dynamisme. Ainsi Miles Davis, en travaillant avec son quintet sur l’album Kind of Blue, a-t-il jeté à l’eau ses musiciens, leur faisant expérimenter leur vulnérabilité mais en les soutenant. « Le travail d’un leader est de créer la divergence, la dissonance qui va provoquer les gens et les faire sortir de leurs postures habituelles et de leurs schémas comportementaux répétitifs ». Pour Frank J. Barrett, les leaders doivent avoir la « capacité de discipliner leur imagination de façon à voir le potentiel d’un individu ou d’un groupe, même s’il ne s’est pas encore réalisé ».
Huitième principe : « maîtriser l’art du chaos ». En conclusion, Frank J. Barrett récapitule les étapes d’implantation d’une culture valorisant l’improvisation, en insistant sur le fait que le jazz est une source de responsabilité et de créativité. Frais et stimulant.
Par : Kenza Sefrioui
Jazz et leadership, osez l’improvisation !
Frank J. Barrett, traduit de l’anglais par Evelyne Kuoh
Diateino, 224 p., 19,90 €
Le Royaume juif d’Afrique renaîtra-t-il de ses cendres ?
Auteur : Edith Bruder
De plus en plus d’Africains se revendiquent juifs. Les ethnies et les origines sont diverses et les rites religieux se confondent dans une Afrique à la spiritualité abondante. Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs origines ?
Edith Bruder est chercheuse associée à la prestigieuse School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. En 2008 elle publie, The Black Jews of Africa. History, Religion, Identity, chez Oxford University Press. Et en 2014, c’est Albin Michel qui reprend ses recherches et décide d’éditer l’adaptation française de l’étude universitaire. L’anthropologue a mené une minutieuse enquête pour remonter aux origines de quelques ethnies et à leurs pratiques religieuses. Mais qui sont ces juifs d’Afrique ? Et surtout, comment se revendiquent-ils du judaïsme ?
La chercheuse s’est attelée à croiser les paramètres, les informations pour trouver des réponses. « En faisant le choix d’ancêtres hébreux, quelques sociétés africaines ont ré-imaginé- ou peut être retrouvé- au XXème siècle une identité religieuse les associant au peuple juif. L’impact de la Bible sur l’imaginaire généalogique des Africains et des Afro-Américains, les mythes et leurs interrelations avec le colonialisme, les bouleversements de l’histoire sont autant d’axes de clivages autour desquels s’est structuré ce nouvel ordre religieux ».
Bruder s’est intéressé plus précisément aux Africains sub-sahariens et à leurs pratiques religieuses. Son livre commence par se référer aux mythes fondateurs de ces peuples. La plus part de ces Juifs, se considèrent enfants de Salomon et de la Reine de Saba et ils incarnent le Royaume juif d’Afrique. Une origine fantasmée, embellie de génération en génération jusqu’à la totale confusion ! Pour arriver à démêler l’imbroglio, la chercheuse est allée au-delà des sources historiques officielles pour extraire « les indices dont l’histoire conventionnelle n’a pas enregistré les péripéties », prévient-elle de prime abord.
Les communautés juives africaines sont très diverses. Aujourd’hui on ne peut affirmer leur nombre. On dit qu’il s’agit de dizaine de milliers. Les plus connues sont les Zakhor au Mali, House of Israël au Ghana, les Igbo au Nigeria, les Baluba au Congo, les Abayudaya en Ouganda (phénomène unique de conversion massive qui a été vécu comme une révélation communautaire) …Il y a aussi les Lemba au Zimbabwe et en Afrique du Sud, les Tutsi Hebrews of Havilah au Rwanda, Les juifs de Tombouctou, (qui pourraient être des descendants des juifs du Touat qui ont fuit des exterminations au XVème siècle)…On peut recenser également, les Beth Yeshouroun au Cameroun (reconnus par le rabinnat en seulement quatre ans) contrairement aux Falashas qui n’ont été reconnus que tardivement, dans les années 80… aujourd’hui, une nouvelle communauté se revendique juive, il s’agit des Beta Abraham.
Ces communautés sont aussi diverses du point de vue ethnique que dans leurs pratiques religieuses et spirituelles.
Dans cette masse hétéroclite, les amalgames sont aussi nombreux. Et les missionnaires de l’époque coloniale en sont pour quelque chose.
Ces derniers ont associé les rites qu’ils ne connaissaient pas à ceux de l’ancien testament. C’est ainsi que certains peuples ont été identifiés comme Hébreux. Ce qui a été réintégré chez ces derniers. Pourtant, dans certaines communautés identifiées comme juives, on reconnaît des pratiques qu’on pourrait qualifier de « peu orthodoxes ». En effet, les juifs d’Afrique pratiquent un judaïsme mélangé à des rites africains. D’autres fois, les croyants vont également à l’église ou à la Mosquée !
C’est le cas de certaines tribus de l’Afrique australe. L’exemple des Lemba semble édifient. « L’observation de ces groupes révèle que leur système de croyance se situe aux frontières de plusieurs traditions religieuses et inclut, entre autres, des règles strictes caractéristiques du judaïsme concernant la circoncision, l’alimentation, la pureté, l’endogamie. L’affirmation de leur ascendance juive repose sur une forte tradition orale concernant un exil antique, au VIème ou VII ème siècle avant notre ère, lorsque leurs ancêtres juifs émigrèrent comme marchands depuis le nord du Yémen où il s’étaient installés après l’exil Babylonien »
Les origines juives des tribus africaines ont surtout été apportées par la tradition orale. Il n’y a pas de source directe pour les établir. Et l’Afrique comme on le sait, ne s’écrit pas, elle se dit !
Par ailleurs, la colonisation a été un facteur important et déterminent des pratiques religieuses en Afrique. Les esclaves ont dû suivre la religion de leurs maîtres sans trop savoir pourquoi. Aux îles Canaries un certain Lucien Wolf a recueilli un ensemble de témoignages d’esclaves indiquant un fort prosélytisme au XIX ème siècle. Un esclave noir affirmait que « ses employeurs ont tenté de lui faire adopter leurs coutumes (juives) sous la menace ». Tandis qu’un autre affirmait qu’il ne travaillait pas le samedi parce que son maître lui avait ordonné de ne rien faire…
Ce phénomène reste très peu étudié. On a toujours porté plus d’intérêt à suivre les conversions chrétiennes que juives en terre d’Afrique. Seulement quelques témoignages donnent à voir cet aspect.
Si les Israélites de la Bible avaient pour ancêtres les douze fils de Jacob, aujourd’hui il est difficile d’établir la filiation de ces milliers d’Africains qui se disent des dix tribus perdues d’Israël. Le mythe a la peau dure et la science n’a pas dit son dernier mot.
Par : Amira-Géhanne Khalfallah
Edith Bruder
Black Jews
Albin Michel
315 pages
297 DH.
Défense et illustration des sciences sociales
Auteur : Le collectif Champ libre aux sciences sociales
Le collectif Champ libre aux sciences sociales rappelle l’importance de ces disciplines dans un projet démocratique et s’inquiète de leur marginalisation.
Sociologie, histoire, science politique, ethnologie, économie politique… les sciences sociales sont aujourd’hui menacées. Le collectif Champ libre aux sciences sociales tire la sonnette d’alarme sur la relégation, à l’Université, dans le champ éditorial et dans les médias, de ces disciplines pourtant si nécessaires. « Aujourd’hui, de plus en plus, lorsqu’elles ne servent pas d’expertise aux pouvoirs, les sciences sociales sont rendues invisibles, interdites d’usage. Résultat : on ne perçoit guère, dans l’espace public, que les conséquences de mécanismes sociaux, et non leurs causes. » Cette relégation est, selon les 250 signataires de ce manifeste publié en mai 2013, loin d’être le fruit du hasard, mais la conséquence savamment orchestrée des politiques néolibérales. Ce constat n’est pas fait uniquement par les universitaires ou les chercheurs, mais également par des éditeurs, des libraires et des journalistes de terrains qui entendent « restaurer la place de la fonction critique des sciences sociales et travailler à l’articulation entre tranchant critique des luttes sociales et vif de la critique en sciences sociales ».
C’est que les sciences sociales dérangent. Elles « sont critiques ou elles ne sont pas. » Allant à l’encontre du « prêt à penser », elles dévoilent « comment les discours les plus entendus sur le bien commun masquent et légitiment les intérêts particuliers des puissants ». Elles « ne cessent de rappeler que ce que l’histoire a fait, l’histoire peut le défaire » et que « la connaissance des logiques de domination est le point de départ et le levier de la résistance à la domination ». En restituant leurs conditions de production historiques et sociales, elles démolissent les indiscutés et désacralisent les évidences. « Aucune position sociale, aucune croyance, aucune relation sociale n’est intangible, nécessaire, tenant à la « nature des choses » ». Les sciences sociales combattent « la vision fataliste de l’évolution des sociétés » et offrent « un autre horizon des possibles ». Les sujets dont elles s’occupent ont pour point commun la lutte contre les injustices. De plus, les sciences sociales sont intimement liées au développement de l’État providence, « qui fait du service public et de la connaissance sociale sa raison d’être », et indissociables « des grands systèmes de promotion et de protection sociales (enseignement, santé, Sécurité sociale) ». Elles sont donc à double titre la cible des politiques néolibérales.
Pour démolir l’indiscuté et les sacralisations
Les signataires s’alarment des ravages de ces politiques. « Une série de processus, à l’université, dans l’édition et les médias, se conjuguent et se renforcent mutuellement pour reconfigurer les conditions de production et de diffusion des sciences sociales, de sorte que leurs travaux sont dénaturés, rendus inaudibles et invisibles ». En cause, l’application de logiques de rentabilité, de rationalisation et de concentration propres au marché, « au nom de la modernisation et de l’excellence ». A l’Université, fusions, contractualisations, organisation de la concurrence ont abouti en France au « report » des recrutements (comprendre à leur annulation), à la réduction des heures d’enseignement au nom de l’autoformation par internet, voire à la faillite de certains établissements. D’où le rétrécissement des horizons des recherches et le conformisme lié à la concentration. Le financement de la recherche par projet la rend conditionnelle et non pérenne et la mise en concurrence des chercheurs, par une évaluation permanente, « creuse les inégalités et conforte les positions préalablement dominantes ». Pire, avec les plaintes en diffamation, « c’est aussi sur le terrain judiciaire que l’on s’emploie à bâillonner les disciplines et les chercheurs critiques ». Sans oublier « les efforts faits par des responsables patronaux et des militants politiques pour éliminer de l’enseignement économique les théories de Keynes ou de Marx qui leur déplaisent »… Les signataires dénoncent par ailleurs la « révolution conservatrice » dans l’édition, où la concurrence intense, les impératifs d’une rentabilité à court terme et « le poids neuf des pôles commerciaux et des responsables financiers » imposent « le modèle de l’entertainment » et occultent le travail de construction d’un lectorat et le rôle social et politique de passage d’idées : « Si bien que les investissements à long terme sur l’avant-garde et l’édition de recherche sont sacrifiés au profit des best-sellers, des ouvrages vite pensés ». Ce qui rend nulles les chances de publication des chercheurs. Quant aux médias, ils les relèguent au rang de « personnes ressources » quand ce n’est pas de « faire-valoir ». Une situation liée, dès les années 1970, à « l’inversion des rapports de force symboliques entre « intellectuels » et journalistes au bénéfice des seconds », du moins « pour les plus dominants » d’entre eux, tandis que les plus précaires sont écrasés par la contrainte du temps.
Or, ces trois champs sont liés par une même mission de diffusion de connaissances critiques. Le manifeste appelle à « inventer une alliance inédite, un front commun d’éditeurs indépendants, de libraires indépendants, de lectrices et de lecteurs, de productrices et producteurs de sciences sociales ». La pierre angulaire de cette mobilisation passe par le refus de l’usage de la neutralité axiologique comme « un paravent » pour ne pas voir les privilèges, à commencer par les siens. Les signataires soulignent la « dette de lucidité » qu’ils ont vis-à-vis des militants qu’ils ont accompagné : « La disposition à l’engagement, qui est d’abord une disposition critique à l’égard du monde tel qu’il va, peut donc être reconvertie en disposition critique et en engagement dans la science, en déconstruisant les catégories de pensée et de classement qui se donnent pour seules légitimes, seules admises et admissibles ». Cette reconnaissance du je engagé vise à valoriser le travail de terrain, le seul qui permet de parler en connaissance de cause. Et de citer Emile Durkheim « Nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces derniers : c’est, au contraire, pour mieux les résoudre. »
Par : Kenza Sefrioui
Manifeste : la connaissance libère
Champ libre aux sciences sociales
Editions du Croquant / La Dispute, 64 p., 5 €
Méditerranée : relançons le voisinage !
Auteur : Jean-Louis Guigou
Jean-Louis Guigou, délégué général de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED), relance le débat sur la complémentarité Nord-sud et écrit : Le nouveau monde méditerranéen.
Le Nord et le Sud, n’ont plus le choix que d’exister ensemble, de collaborer dans l’équité pour un développement plus écologique et social dans des rapports équitables. L’Asie et l’Amérique l’ont bien compris. L’Europe devrait aussi tirer profit des innombrables opportunités qu’apportent les pays du Sud mais sans les erreurs du passé. Eviter les rapports de supériorité et d’obédience y va de l’avenir de tous. La coopération est la seule solution pour bâtir le futur. Pour cela, les bases sont « une économie décentralisée et productive, participative et anticipative, et non pas ce capitalisme financier, court termiste, globalisé, mais sans régulation et spéculatif », prévient l’économiste.
Jean-Louis Guigou explique comment établir des relations justes et de confiance entre les deux bords de la Méditerranée en prenant compte de la nouvelle configuration post- révoltions arabes. Il faut commencer d’abord par définir les besoins. Ces derniers semblent clairs. Les pays du Sud possèdent la jeunesse, les marchés et l’énergie, l’Europe de sa part peut apporter, les technologies et la gouvernance. « Les sociétés arabo-musulmanes en pleine révolution se découvrent plurielles et cherchent elles aussi un « compromis historique » entre les croyants fanatiques et les musulmans laïcs. De son côté, l’Europe élargie libérale et intergouvernementale est à bout de souffle et plus largement, l’ère post-occidentale est engagée face aux grands émergents et aux grandes régions mondiales », renchérit Guigou. Pour sortir de l’impasse, il propose un plan de convergence qui rapproche l’Europe de l’Afrique et non de La Chine. Cette proximité favoriserait les échanges économiques (surtout énergétiques : solaire dans un proche avenir) sans oublier l’aspect civilisationnel et les convergences culturelles des deux bords de la méditerranée. Mais pour atteindre ces objectifs, il faudrait établir des règles économiques, écologiques et éthiques claires. « Agissons à contre courant », lance Jean-Louis Guigou qui précise qu’aujourd’hui « l’avenir de l’Europe passe par la Méditerranée et que l’avenir des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée passe par un arrimage à l’Europe ».
Mais comment embarquer dans ce nouveau monde ? Les tentatives du passé se sont avérées désastreuses. Pour comprendre les enjeux du présent, il faudrait peut être se tourner vers ce passé si peu glorieux mais qui peut aiguiller notre avenir.
Pour cela l’auteur nous conduit aux origines de la « crise méditerranéenne » qui a coïncidé avec la découverte de l’Amérique. Le nouveau monde a fasciné avec l’abondance de ses richesses. L’Europe a alors délaissé l’Afrique et s’est tournée vers l’Amérique. Mais trois siècles plus tard, l’Amérique a chassé ses conquérants. Le clivage a été irréversible en 1776 date de la création des Etats-Unis.
Le retour de l’Europe en Méditerranée…
Les Européens en sont revenus forts. Leurs voisins du Sud n’ont pas connu la même croissance. L’Europe de plus en plus puissante va coloniser l’Afrique et le monde arabe avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd’hui. (Source de conflits insolvables notamment au Moyen-Orient).
Mais nous sommes aujourd’hui à une toute autre époque, celle qui annonce un nouveau cycle économique, un cycle long, disent les économistes. (troisième révolution industrielle selon Rifkin).
A l’heure de la transition énergétique et de la révolution numérique, il est indispensable de repenser, les liens et les rapports entre les Etats. Depuis toujours, les relations entre pays sont jugées du point de vue commercial et politique. Guigou nous propose un autre schéma et une toute autre analyse qui s’appuie d’ailleurs sur des travaux antérieurs (notamment ceux de Jacques Berque).
La différence entre les pays est une richesse qu’on pourrait exploiter autrement qu’à travers des conflits et la colonisation. Ces différences culturelles, géographiques, politiques peuvent aboutir à ce que Berque a dénommé la Méditerranée plurielle, « faite de jonction, de mixité, de respect mutuel….je rajouterai d’innovation scientifique, économique et culturelle », complète l’auteur.
Guigou propose ainsi de relancer le voisinage. Nous avons aujourd’hui, trente ans, selon l’essayiste pour y arriver. L’avenir est à une « communauté euro-méditerranéenne de l’énergie, un élargissement du mandat de la Berd à ces pays, une augmentation du soutien financier, une plus grande ouverture aux entreprises et aux initiatives de la société civile ».
Sur l’ensemble des relations commerciales, l’Europe est le premier partenaire des pays du sud-méditerranéen. Mais aujourd’hui cela ne suffit plus ! Les ressources des pays du Sud s’épuisent. Quel avenir pour les deux rives alors ?
Il est temps de mettre en place un ancrage en profondeur, de poser les bases d’un partenariat égalitaire, et cesser de voir en l’autre une source d’énergie sans plus. Un nouveau modèle est à inventer. Il semblerait qu’il est à chercher non seulement du côté des politiques mais également de la société civile.
Guigou propose de donner la parole en Europe aux musulmans progressistes et patrons d’entreprises, la création d’un secrétariat d’Etat aux études méditerranéennes, mettre sur pied une institution financière euro-méditerranéenne, lancer un programme d’échange d’expériences et de brassage des élites…
Mais quels moyens pour faire aboutir d’aussi ambitieux projets, Guigou ne le dit pas dans son ouvrage !
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Jean-Louis Guigou
Le nouveau monde méditerranéen
Descartes & Cie
Casa express Edition
157 pages
100 DH
Valeur multiforme
Auteur : Philippe Taché
Philippe Taché explique le processus de création de valeur à chaque stade de la vie de l’entreprise et souligne l’étroitesse du point de vue uniquement financier.
La valeur ne peut pas se résumer à une donnée chiffrée : c’est aussi tout un ensemble de choses immatérielles. « La valeur comptable ne restitue qu’une image incomplète de la valeur de l’entreprise », martèle Philippe Taché, manager responsable de formation dans un cabinet spécialisé dans la conduite du changement. Pour lui, « la réalité des entreprises, celle de leur diversité, ne peut être traité par une approche unique. La réalité des chiffres n’est pas suffisante pour rendre compte de toutes leurs dimensions, de leurs capacités, de leur adaptabilité, de l’adhésion de leurs équipes… » L’auteur s’insurge contre un courant de pensée qui tente de « nous faire croire que la spéculation est un phénomène normal qui ne peut et surtout ne doit pas être freiné, qui doit devenir la norme ». Il rappelle qu’il y a d’autres modes de création de valeur. Certes, la notion évolue : « le millénaire précédent voyait dans la valeur des équivalents concrets. Maintenant, la virtualité a envahi notre univers ». Mais la valeur reste intrinsèquement liée à l’entreprise, laquelle n’est pas « hors sol » mais « le produit de la société dans laquelle elle se développe ». Philippe Taché compare volontiers celle-ci à un corps humain, dans sa recherche d’équilibre interne et externe, adapté à son milieu, et distingue deux types de valeur : « celle qui va irriguer l’économie et celle qui va transformer l’entreprise ». De plus, la valeur n’est pas figée : elle évolue à chaque phase de développement de l’entreprise. Donc on peut en piloter les conditions de transformation, pour peu qu’on ait la maîtrise du processus et de ses rythmes dans le temps et qu’on sache anticiper les transformations.
Philippe Taché distingue quatre phases. A la création de l’entreprise, la valeur se caractérise par un droit à exercer son activité, un cadre juridique et financier, etc. C’est surtout une « réserve de valeur », liée aux potentialités de réalisation de l’entreprise. Il s’agit de « valider le projet initial auprès de ses premiers clients » en développant une identité. Il faut donc connaître la demande, identifier une cible et ses besoins, concevoir une offre, la présenter, trouver des clients, réaliser du sur-mesure, maîtriser le besoin de fonds de roulement, maîtriser l’activité, connaître les soutiens et obligations réglementaires, mettre en place les bases contractuelles et recruter les ressources humaines, et enfin les encadrer et déléguer.
L’équilibre avant tout
La phase suivante est celle de la construction de l’entreprise, où l’objectif est d’augmenter le chiffre d’affaires, d’accroître la visibilité de l’entreprise et de finaliser la mise en place des méthodes et/ou des outils. Cela suppose d’industrialiser les réalisations, d’accroître les fonds propres, de normer l’activité, de cadrer profits et de renforcer les capacités managériales, et de créer un esprit d’équipe. Les compétences requises à ce stade sont la connaissance de la concurrence et de son offre, afin de s’adapter et de trouver des facteurs de différenciation. L’écueil est souvent d’orienter l’énergie « vers le développement commercial, l’accroissement du chiffre d’affaires » au détriment du reste, mais aussi un « flou stratégique » qui peut bloquer le passage à l’étape suivante.
Lors de la phase de structuration, l’entreprise « va se poser la question d’une affectation optimale de ses ressources et moyens, externaliser les activités non stratégiques, se concentrer sur ses savoir-faire ». Elle doit accroître sa résilience, positionner son activité dans le marché face à la concurrence et organiser son développement en se diversifiant ou en se spécialisant. Elle doit relever le défi commercial de pénétrer de grands comptes, maîtriser et développer ses méthodes différenciantes, cadrer les processus de délégation et de prise de décision et mettre en place une chaîne de management. Ici, elle doit savoir identifier les segments stratégiques pour l’entreprise, et connaître le marché de chacun de ces secteurs stratégiques en identifiant ses tendances à venir.
Enfin, à la phase de l’optimisation, l’entreprise cherche à accroître sa profitabilité. Elle recherche donc l’efficience, rationalise ses processus et se concentre sur ses savoir-faire essentiels, quitte à externaliser ou à internaliser certaines activités. A ce stade, elle concentre ses efforts sur les marges et les relations à potentiel, protège et diffuse ses méthodes et techniques novatrices, lève des fonds pour réduire le coût du financement, gère les parcours des ressources humaines et diffuse une culture d’entreprise. Ce qui suppose d’accroître sa notoriété et de personnaliser ses relations, de maîtriser les modes de communication et de connaître les médias adaptés pour faire connaître ses offres.
A travers cette description de la vie de l’entreprise, l’auteur souligne trois compétences essentielles : « transformer les actions/productions/prestations en éléments valorisables », maîtriser « les différents rythmes de création, de prélèvement et d’accumulation de valeur » et réaliser l’équilibre entre la valeur destinée à l’extérieure et celle qui sera accumulée pour accroître la capacité de réalisation de l’entreprise. Il insiste sur l’importance d’une analyse pertinente des points clef du développement et de la cohérence du dispositif de création de valeur pour pouvoir piloter l’entreprise. Il propose donc d’analyser la cohérence fonctionnelle de l’entreprise à chaque étape, et d’étudier « la chaîne de valeur », en s’inspirant des travaux de Michaël E. Porter sur l’analyse sectorielle et l’étude de la concurrence. Vient ensuite l’analyse des risques, via trois questions – que se passera-t-il si on ne fait rien ? Comment le processus de création de valeur évoluera-t-il ? Quel risque présente la mise en œuvre d’un projet qui va transformer l’entreprise ? – et la formulation de plusieurs scénarios. Pour Philippe Taché, « une entreprise dont le développement est cohérent doit montrer une homogénéité du niveau atteint sur l’ensemble des axes contributifs », à savoir l’axe commercial, celui des techniques et des méthodes, celui des finances, celui de l’organisation, celui des ressources humaines et enfin celui du management. Après des études de cas et des exercices corrigés, la dernière partie de cet ouvrage très concret propose un inventaire des « bonnes pratiques de la création de valeur » et recense les pièges à éviter. Un mode d’emploi bien utile.
Par : Kenza Sefrioui
Créer de la valeur
Philippe Taché
Eyrolles, Les leviers du développement,192 p., 18 €
Syrie : Les racines d’un mal profond
Auteur : Ziad Majed
Ziad Majed, Politologue libanais et professeur des études du Moyen-Orient à l’Université américaine de Paris décortique la guerre en Syrie, revient sur les débuts de la révolte, s’introduit dans ses ramifications et la dissèque.
A l’heure où Ziad Majed écrivait son livre : Syrie, la révolution orpheline, on comptait quelque 130 000 morts dont 11 000 enfants et 8 millions de déplacés. Depuis, ces chiffres ont bien évolués. La Syrie ne compte plus ses morts, ses villes détruites et ses sites archéologiques perdus à tout jamais.
S’il n’y a pas eu ce printemps tant attendu à Damas c’est que le régime Al Assad a mis en place un système quasi infaillible. Toutes les issues à un changement ont été verrouillées.
Pour être sûr de l’allégeance de son armée et de son soutien à toute épreuve, le père Al-Assad avait trouvé un plan machiavélique : Un officier de l’armée syrienne est d’abord un alaouite partisan du Baâth. Ainsi en une seule personne se résume l’appartenance religieuse, politique sous l’emblème des armes !
Le bâtisseur de la dictature syrienne a également encouragé l’exode rural. Ainsi les partisans du Baâth pour la plupart, fils de cultivateurs ruraux, pénétraient les villes et son tissu social. Hafez Al Assad a aussi « tissé des relations avec les commerçants et hommes d’affaires en favorisant leur prospérité en échange de leur allégeance et leur éloignement du domaine politique »
Pour générer de l’argent, la minorité alaouite a permis la corruption et l’a même encouragée. Et enfin un des éléments qui a servi le pouvoir de cette minorité régnante : l’instauration d’une violence sans limites (qui a a atteint son apogée dans les années 80 sous le régime du père). « La principale raison qui explique le succès du régime syrien dans la mise au pas de la vie publique, en tant que participation politique, action sociale et éthique citoyenne est sa capacité progressive à confisquer le domaine public, les espaces d’expression et tous les lieux de rassemblement et d’organisation, à travers soit la récupération, soit l’exclusion », explique le politologue.
Dans l’empire Al Assad, il y a eu tout de même un imprévu, la mort dans un accident de voiture du grand héritier de cette oligarchie, le fils ainé Bassel. C’est ainsi que Bechar qui était étudiant en ophtalmologie à Londres a été désigné successeur de son père.
Bechar que rien ne prédestinait à une carrière politique s’est tout de suite senti à l’aise au jeu du pouvoir. Il a pris deux dossiers en main (plutôt deux ennemis): Le Liban et les turco-kurdes.
Juste après la mort du père, le fils change la constitution et organise sa propre intronisation à l’âge de 34 ans. « Le royaume du silence » * est né.
Bachar a entretenu tout ce que son père a construit. « Les restrictions sont ainsi maintenues dans tout ce qui touche aux libertés publiques, tandis qu’un feu vert était donné aux membres de la famille et à ses proches pour monopoliser les nouveaux secteurs économiques- ou les entreprises privatisées- qu’il s’agisse des réseaux de téléphonie mobile, et de l’Internet, des services bancaires ou des cartes de crédit, des chaînes touristiques propriétaires de restaurant et de sociétés de transport ou encore de l’industrie de pétrole et du gaz et de l’agroalimentaire… ». Ainsi, tout le pays était sous contrôle d’Al-Assad.
Des djihadistes et des Chiites
Lorsque les premières manifestations s’installent dans la rue syrienne, elles sont vite réprimées par l’armée et Bachar sort sans attendre l’artillerie lourde. L’arrestation des jeunes tagueurs à Deraa n’a fait que mettre le feu aux poudres. La résistance commençait à s’organiser et … la répression aussi. Dans l’armée syrienne certains s’insurgent et rejoignent l’opposition. Mais très vite ces quelques dissidents se retrouvent sans ressource, tandis que les islamistes et les groupuscules d’obédience radicale sont soutenues par : La Turquie, Le Qatar et l’Arabie Saoudite.
De l’autre côté Al Assad fait appel à ses alliés qui s’avèreront fidèles à toute épreuve : La Russie, l’Iran et La Chine. C’est là que commence la guerre qu’on connaît.
Al Assad va également profiter de la présence de groupes djihadistes pour justifier la violence et l’extermination de son propre peuple. Les Iraniens interviendront hors de leur pays, en aidant à la logistique, au combat sous couverture de protection de sites chiites (l’un des plus emblématiques est celui de Sayyeda Zeineb). Au début de l’année 2013, ont voit se dessiner les prémices d’une guerre de fractions religieuses qui pourtant ne se justifie que par la présence des Iraniens en Syrie. « Mais les deux camps de cette guerre ne sont pas à responsabilité égale. Les djihadistes ne sont pas majoritairement syriens ou n’ont pas de références syriennes, et les islamistes syriens engagés dans la révolution ne cherchent pas querelle aux chiites et n’envoient pas leurs combattants en Irak ou au Liban pour y alimenter les conflits ».
Le 21 août 2013, l’armée syrienne attaque à l’arme chimique et tue des centaines de personnes au gaz sarin. La communauté internationale s’émeut… pendant deux semaines ! Poutine réussit un coup de maître et évite à son allier une intervention internationale en le convaincant de renoncer à son arsenal chimique.
L’abandon de la communauté internationale de la question syrienne a permis à Al Assad de continuer à massacrer sa population et à pilonner les villes qui lui résistaient, les assiéger et les tuer de faim.
« C’est ainsi qu’une révolution populaire et pacifique qui a revendiqué, la liberté, la justice et la fin de quatre décennies de tyrannie et de corruption, s’est transformée en une guerre sanglante sans issue prévisible entre un clan capable d’anéantir le pays pour se maintenir et des fractions armées à dominante islamiste ». La Syrie et toute la région du Levant semble bien partie dans un infernal cycle de violence dont on connaît bien les origines mais nullement la fin.
Par : Amira Géhanne Khalfallah
*Le royaume du silence : appellation consacrée par l’opposant au régime syrien, Riyad Al-Turk
Syrie la révolution orpheline
Ziad Majed
Sindbad. Actes Sud
L’Orient des livres
161 DH.
Défi au sens commun
Auteur : Sophie Coignard et Romain Gubert
Sophie Coignard et Romain Gubert dénoncent les dangers, pour l’intérêt général, de la collusion entre Etat et capitalisme débridé.
Le 10 octobre 2013, Richard Portes était invité à l’Université Paris-Dauphine. L’économiste enseignant à la London Business School avait réalisé pour le compte de la chambre de commerce islandaise un diagnostic sur son système financier, dont il chantait les louanges… à quelques mois de sa faillite : pas un mot sur cette désastreuse analyse. « Aujourd’hui, le conformisme admet que l’épisode le plus marquant de la vie professionnelle d’un économiste soit supprimé de sa biographie », relèvent les journalistes Sophie Coignard et Romain Gubert, scandalisés par cette « caste cannibale » dont même la crise de 2008 n’a pas réussi à briser l’omerta. « Il y a dans cette manière de fonctionner quelque chose qui rappelle le système stalinien, commentent les coauteurs de L’Oligarchie des incapables (Albin Michel, 2012). Une sorte de déni collectif qui se fracasse chaque jour davantage sur le mur de la réalité ». Leur enquête, en 23 chapitres centrés sur l’expérience française, dénonce les ravages produits par la collusion entre l’Etat et le capitalisme sans limite.
Les navettes incessantes entre le public et le privé tissent d’abord des liens dangereux entre décideurs politiques et banques d’affaires ou hedge funds : alors qu’hier, ces dernières « se contentaient de conseiller les Etats dans toutes leurs transactions ; demain, elles seront peuplées d’anciens ou de futurs ministres, chefs d’Etat et de gouvernement. L’équilibre des forces, désormais, penche de leur côté ». Des personnalités politiques (Sarkozy, Clinton, Aznar…) figurent désormais au catalogue du Washington Speakers Bureau, PME créée en 1979 en Virginie, offrant leurs services grassement rémunérés pour des conférences… Ces va-et-vient, renforcés par les effets de génération (promotions d’énarques et d’HEC) finissent par reléguer à l’arrière-plan sinon à occulter la notion d’intérêt général.
Entraves à l’action de l’Etat
Les auteurs déplorent la léthargie des pouvoirs publics face aux techniques (souvent légales) d’optimisation fiscale abondamment pratiquées par des entreprises comme Starbucks, Amazon, Google, Apple…, et notamment face à la domiciliation de sièges sociaux dans des paradis fiscaux, léthargie qui s’explique en partie « par le désir de chacun de chouchouter son paradis fiscal à lui ». Or cette question constitue un « enjeu économique majeur » pour les pays étranglés par la dette publique et noyés dans les déficits. De même, rien n’est fait pour lutter contre la pratique prédatrice mais légale du leverage buy out (LBO), qui consiste à racheter une entreprise sans rien dépenser et à la faire rembourser le crédit. « La liste des grands malades qui, sans l’intervention des prédateurs, seraient des entreprises tout à fait saines, est impressionnante ». Sophie Coignard et Romain Gubert s’indignent aussi que le Crédit impôt recherche soit employé à subventionner l’activité « trading haute fréquence » des banques françaises, « symptôme le plus évident de la dégénérescence du monde financier » puisqu’il s’agit d’un dispositif où des « supercalculateurs jouent les uns contre les autres en passant des centaines de milliers d’ordres de Bourse chaque seconde en fonction de logiciels qui n’ont plus aucun lien avec l’économie réelle »… Les auteurs doutent d’autre part de l’efficacité des Partenariats public-privé (PPP), qu’ils considèrent comment « l’antichambre de la corruption » quand il ne s’agit pas de pièges pour les Etats. Plus grave encore, l’idéologie du « fabless » ou de l’entreprise sans usine, prônée par Serge Tchuruk, ancien patron de Total et d’Alcatel, au bilan plus que contestable mais à la retraite dorée : « Plus d’usines, plus d’ouvriers, mais uniquement des sous-traitants auprès desquels on peut tirer sur les prix sans vergogne »… Ce système, qui dilue les responsabilités à l’infini, est abondamment pratiqué par Apple, qui ne produit pas un seul iPhone en direct – « Cela s’appelle le « branding », la gestion de marque, du marketing sans jamais mettre les mains dans le cambouis ») – mais sous-traite à Foxconn, son principal fournisseur, premier employeur de Chine avec 1,2 millions de salariés, qui réalise plus de 40 % de tous les produits électroniques dans le monde : dans son usine de Longhua, qui produit 150 000 iPhone par jour, 100 par minute, les salariés, logés dans des dortoirs, travaillent six jours sur sept pour un salaire qui ne leur permet pas d’acheter ce qu’ils fabriquent – « On est loin du modèle de Henry Ford ! » – et, face aux suicides à répétition, la direction a installé des filets pour les empêcher de sauter. Enfin, les auteurs dénoncent le « conflit d’intérêts permanent » à propos des agences de notations, puisque S&P, Moody’s et Fitch « sont payés directement par ceux qu’elles doivent juger », et le fait que la Banque centrale européenne ait renoncé à ses prérogatives en les hissant « au rang de quasi-régulateurs ».
Ce livre à charge dénonce le cynisme des tenants de cette doxa. Carlos Ghosn, numéro deux de Renault ? « Il emploie des mots neutres, dénués de tout caractère affectif pour décrire son action. Pas de charrette, pas de gestion par le stress, pas de gouvernement par la peur. Non, le propre du cannibale est de bien cacher son jeu » : des méthodes totalitaires, basées sur la paranoïa. Le désengagement de l’économie réelle, la disproportion entre la rémunération des patrons et celle des salariés, la captation des richesses[1], le soutien à des dictatures, l’absence de discrédit malgré les conséquences catastrophiques de diagnostics hasardeux ? Peu importe : « Qu’un grand patron fasse très bien ou très mal son travail, il touchera en moyenne plus de 3,5 millions d’euros chaque année. » Et quand Thomas Herdon, étudiant à l’Université du Massachusetts, montre que l’étude de Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff qui inspire les politiques d’austérité depuis 2010 est basée sur des calculs tronqués, il n’a pas été entendu… Face à cette idéologie à la peau dure, quid du capitalisme sans risque ? se demandent les auteurs ? « Erreur 404 » ! En dénonçant l’impunité et la versatilité de ceux qui se souviennent de l’utilité de l’Etat uniquement quand ils ont des problèmes, ils lancent un appel à la lucidité et au sens des responsabilités.
Par : Kenza Sefrioui
La caste cannibale, quand le capitalisme devient fou
Sophie Coignard et Romain Gubert
Albin Michel, 336 p., 20 €
[1] « Les 1 % « d’en haut » ont capté à eux seuls 95 % des gains liés à la reprise survenue entre 2009 et 2012. Durant la même période, leurs revenus ont augmenté de 31,4 %, contre 0,4 % en moyenne pour les 99 % restants, autrement dit la quasi-totalité de la population américaine », selon les économistes Thomas Piketty et Emmanuel Saez.