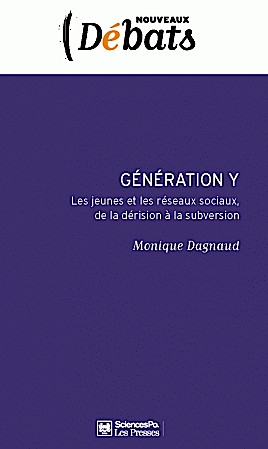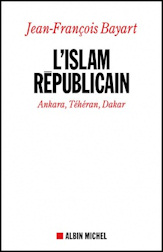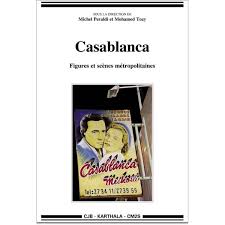Métro, boulot, bobo
Auteur : Pierre Bardelli et José Allouche
Invitation à réinventer le lien social par le travail, ce livre collectif présente une réflexion d’utilité publique.
Stress, fatigue, angoisse, mal-être, dépression, troubles musculo-squelettiques ou psychosociaux, absentéisme, accidents, épuisement professionnel (burn out), perte de l’estime de soi et d’autrui, sacrifices familiaux, suicides, voire karoshi (mot japonais qui désigne une mort subite par excès de travail)… les manifestations de la souffrance au travail se sont multipliées et sont devenues un véritable fléau mondial. Avec un coût énorme pour la société : « Dans les Etats de l’Union européenne, le coût total des problèmes de santé au travail représentaient au total entre 2,6 et 3,8 % du PIB » en 1999, relève Manuela Pastore-Chaverot. « Les seuls TMS ont engendré en France la perte de 7,4 millions de journées de travail, et 736 millions d’euros de cotisation d’entreprises ont été nécessaires pour en couvrir les frais ». 24 chercheurs, sous la direction de Pierre Bardelli et José Allouche, se sont penchés sur cette douloureuse question. Ils l’ont envisagée sous différents angles (gestion, économie, sociologie, psychologie et médecine) avec des approches transdisciplinaires afin d’identifier les processus générateurs de souffrance au travail et de déterminer les responsabilités. Au cœur de leur recherche, un discours qui s’est développé dans les grandes entreprises surtout occidentales : la Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). A côté de ses impératifs de production et de ses méthodes de communication et de management, l’entreprise affiche son éthique. Les 15 études questionnent les capacités réelles de ce discours à prévenir la souffrance et sa pertinence en matière de régulation sociale. En fait, elles en montrent les limites.
Repenser le travail
La souffrance au travail est en effet la conséquence directe de l’expansion du management libéral : le modèle pensé pour l’industrie est désormais appliqué à l’ensemble des activités, qu’elles soient marchandes ou non. L’heure est à toujours plus de flexibilité, dans les horaires, dans les salaires, etc., imposant aux travailleurs sans cesse mis en concurrence une véritable dictature de la performance et de l’urgence. Plus que le professionnalisme et l’humanité, ces nouveaux modes de management valorisent les gestes techniques. On en perd le sens du travail. Stocks zéro, intensification des rythmes, réduction des effectifs, déséquilibre entre l’effort et la récompense, harcèlement multiforme… en période de crise, le salarié n’est pas sécurisé, et hésite à quitter son emploi de peur de ne pas en retrouver. « Les effets du dumping social nivellent par le bas les conditions de vie des travailleurs et des populations concernées des pays dits riches », déplorent Khalid Djeriri et Alain Chamoux. Plus grave, avec l’effacement de l’Etat, ce sont les entreprises qui sont désormais en charge de la régulation sociale:« On abandonne l’idée de politique sociale, de régulation publique, au profit du principe purement microéconomique et fondamentalement apolitique de responsabilité des acteurs économiques », s’inquiètent Jean-Marie Cardebat, Thierry Debrand et Nicolas Sirven, qui soulignent le fait que la RSE est souvent un discours creux, proclamant une bonne pratique dont il n’assume pas le coût.
En effet, l’entreprise nie l’augmentation de la souffrance au travail et estime ne pas y avoir de responsabilité. Mieux, elle utilise la RSE comme un moyen de contourner les instances classiques du dialogue social, comme les syndicats. Ceux-ci y ont d’ailleurs été longtemps réfractaires, avant d’y proposer leur vision. Discours « autoproclamé par la direction » et toujours positif, la RSE est un « instrument de la violence symbolique ». Selon Jean-Marie Cardebat, Pierre Régibeau et Nicolas Sirven, c’est un discours en décalage avec la réalité des faits : il y est plus question d’environnement, de diversité, de handicap, d’égalité homme-femme, de droits humains que de santé et de souffrance au travail. On y parle formation, écoute, savoir-faire, mais peu motivation, reconnaissance, primes. Les métiers réels (ouvrier, employé, cadre…) disparaissent au profit des « responsabilisés ».Bref, la RSE y présente le monde du travail rêvé par la pensée libérale et se réduit souvent à une « stratégie de valorisation symbolique ». Conséquence : « la santé au travail, en tant que responsabilité de l’employeur, tend à être exclue du débat social pour être portée par le seul salarié », notent Catherine Bodet et Thomas Lamarche, qui relèvent des cas d’incitation voir d’obligation du salarié à ne pas déclarer les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
Outre le rapport de force et l’enjeu d’image qui la sous-tendent, la RSE pose un problème philosophique. Elle repose sur des sciences de gestion, qui ont pour objectif l’utilisation efficace des ressources (notamment humaines), mais pas l’émancipation de l’être humain au travail. D’où la deshumanisation et la réduction du travail à ses seules caractéristiques mesurables, au détriment de sa dimension créatrice. Or, rappelle Jean-Paul Dumont, « dans la dynamique de la construction du sujet, le travail occuperait une place d’égale importance à celle de l’amour ».Les chercheurs mettent en lumière le lien entre la santé et le modèle de régulation. Ils insistent sur la nécessité des espaces de communication. Michèle Heitz et Jean-Pierre Douard plaident par exemple pour « une charte des normes de vie comportant les droits du temps humain ».Face à ce phénomène, les auteurs du livre appellent à une redistribution nouvelle de la valeur, en inventant un système qui remette l’humain au cœur du travail. Cela passe par la restauration des solidarités entre les travailleurs, par une « réflexion d’ensemble sur la question du compromis salarial » et surtout par la mise en place d’une culture où l’on met un terme à « la césure entre le caractère collectif de la production et l’individualisation des responsabilités dans l’organisation » pour « faire reconnaître la dimension sociale (collective) du travail salarié ». Un projet de société novateur, dans lequel tout a à gagner…
La souffrance au travail : quelle responsabilité de l’entreprise ?
Armand Colin, collection recherches, 392 p., 27,50€
Par : Kenza Sefrioui
Génération Y, Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion
Auteur : Monique Dagnaud
Les digital natives approchent aujourd’hui la trentaine et leur manière de faire génération est tout à fait inédite : ils ont connu dans leur enfance l’une des plus grandes révolutions technologiques et sociales, la généralisation d’Internet. Monique Dagnaud, sociologue des médias au CNRS, brosse le portrait de cette classe d’âge qui inaugure une ère nouvelle. Dans un petit ouvrage synthétique et très documenté, elle analyse comment cet outil réorganise les rapports entre les individus, et les valeurs qu’il véhicule à une échelle sans précédent. Car Internet, c’est une véritable rupture anthropologique, avec des changements à divers niveaux.
Le droit à la créativité
L’histoire contre les phobies
Auteur : Jean-François Bayard
Non, «l’islam et la République», ce n’est pas un oxymore. Le livre de Jean-François Bayart est une réponse très intelligente à ce qui est présenté comme un tandem incompatible : l’islam républicain. Aux phobies, celles notamment des initiateurs du sinistre débat sur l’identité nationale en France, l’auteur, spécialiste de politique comparée au CNRS, oppose la réalité de l’Histoire. Celle de trois pays, la Turquie, l’Iran et le Sénégal. Trois républiques. Trois pays musulmans. Trois exemples pour retrouver les questions de fond, qui relèvent de la sociologie politique. «L’islam républicain s’est en effet formé au cours d’une séquence délimitée qu’ont simultanément caractérisée deux phénomènes, généralement présentés sous le visage d’une antinomie, et pourtant synergiques : d’une part, l’universalisation de l’Etat-nation et, de l’autre, les mondialisations d’ordre technologique, matériel, culturel, économique, financier et politique».
Jean-François Bayart consacre l’essentiel de sa démonstration à l’étude du cas turc. Il plonge dans l’histoire de l’empire ottoman et décrypte l’avènement de la République en Turquie. Il s’appuie sur l’étude du pouvoir, de la culture politique des élites, balayant au passage les clichés orientalistes sur la Sublime Porte, en faisant apparaître des parallèles avec l’histoire européenne de l’époque, comme par exemple le rôle des femmes au plus haut niveau de l’Etat, comme régentes. Il analyse les mécanismes du pouvoir, sa façon de produire ses élites, d’établir des liens avec les minorités confessionnelles, les rapports du centre avec la périphérie, impliquant «la construction d’un empire par le bas». Il revient en détail sur la période des Tanzimat1, période d’instabilité politique qu’il analyse comme «releva[nt] de la formation de l’Etat, autant que de sa construction». Il interroge les processus de construction politique d’une identité turque, dans ce qu’ils supposent d’ethnocentrisme et de système de valeurs. Il rappelle que la République a abrogé, en 1928, l’article 2 de la Constitution de 1924, qui instituait l’islam comme religion d’Etat, parce que, dans son projet rationaliste, Kemal Atatürk «était persuadé que l’islam, en tant que religion d’Etat, était antithétique avec l’autonomie de l’individu constitutive de la modernité». Mais il insiste surtout sur l’interaction entre l’islam et la République, «interaction qui a été, et reste, en effet subjectivement conflictuelle du point de vue des pratiques et des discours, mais qui, à ce titre, a également été productrice et de la République et de l’islam républicain». En effet, lors de ce considérable changement d’échelle qu’est le passage d’un Empire à un Etat-nation, des débats sont apparus, notamment sur l’identité ethnique et religieuse. Ainsi, Jean-François Bayart montre les espaces de heurts et de négociations, formulés plus ou moins explicitement, sur ce qu’est être turc : «En Turquie, être turc ne veut pas dire être d’origine turque. Cela signifie être un musulman turc. (…) Un «WASP» turc a besoin de toujours plus de qualifications pour être un turc makbul (acceptable), c’est-à-dire un Turc jouissant de la confiance et de l’estime des élites. Ce Turc doit être hanefi (et non shafi – la plupart des Kurdes sont shafi) ; être sunnite (contrairement aux Alevi) ; musulman (contrairement aux non musulmans) ; et Turc (contrairement à ceux qui ne disent pas qu’ils sont Turcs). Couronnement de toutes ces qualifications, tu dois être enfin un laïque». Mais dans cet espace de négociation, Jean-François Bayart voit un «processus interactif de subjectivation», de «constitution de soi» comme un «sujet moral», qu’il analyse dans les nouveaux espaces de débat, la nouvelle culture et les rapports nouveau à l’économie de marché. Un processus qui relève par définition de l’historicité. Et Jean-François Bayart de conclure que, dans l’histoire de la Turquie, l’islam a été un «principe transitif», au sens où, s’il n’a pas déterminé le passage de l’Empire ottoman à la République turque, il a été un facteur de continuité.
Les deux autres exemples, moins détaillés, servent à montrer des variations historiques. Dans le cas de l’Iran, Jean-François Bayart s’appuie sur les études concernant la Révolution française. Il fait notamment la comparaison entre la révolution de 1979 et le moment dit «thermidorien» de la Révolution française, à savoir son institutionnalisation «grâce à la professionnalisation de son avant-garde militante en classe politique tenante de l’Etat, [qui] véhicule une révolution des intérêts au bénéfice de cette dernière, [et] admet l’inertie du social grâce à une représentation politique de type non démocratique». Jean-François Bayart analyse dans cette optique la trajectoire des Gardiens de la Révolution, à la fois par rapport à leur idéologie révolutionnaire et au champ religieux. Il démontre «le désenchâssement du champ politique par rapport au champ religieux» à travers le rôle des institutions, l’origine sociale des dirigeants, et, bien sûr, la distinction faite entre espace public et espace privé, qui brise de fait l’aspiration à la totalité tant de l’idéologie révolutionnaire que du discours religieux. Enfin, au Sénégal, Jean-François Bayart s’attache à démontrer le rôle qu’ont eu les séquelles d’une histoire marquée par l’esclavage, les anciens combattants dans l’empire colonial et les confréries dans la négociation de la République.
L’ISLAM, PARAMÈTRE HISTORIQUE PARMI D’AUTRES
Dans les trois cas, il montre que l’islam n’a jamais été un facteur d’explication des trajectoires républicaines : «L’islam n’existe pas, historiquement et sociologiquement parlant. Il ne vaut que par les autres termes de la figuration dans laquelle il est pris : un empire ou un Etat-nation, le système international ou régional, les échanges ou les guerres qui le constituent, le type de politique économique, de forces productives et de rapports sociaux de production qui prévalent, le moment contingent que l’on choisit d’étudier. Il ne représente qu’une facette de l’historicité de la société qu’on considère, historicité dont il est indissociable. Répétons-le, l’islam n’est pas une «essence», mais un «événement».
Au travers de trois histoires différentes, Jean-François Bayart montre en effet que les problèmes qui se posent sont en fait universels: la souveraineté, la légitimité du pouvoir, l’organisation des institutions, mais aussi la conception de la conscience politique, et le processus de constitution d’un citoyen moral. Et ces problèmes universels ne peuvent trouver que des réponses contingentes et multiples, liées à leur historicité. Une réponse intelligente et très finement argumentée à des débats nauséabonds, et un appel à revenir à la raison, c’est-à-dire à balayer les catégories hors du champ des concepts opératoires
1 Les Tanzimat correspondent à une période de réformes politiques qui a duré de 1838 à 1876. Il s’agissait d’endiguer le déclin de l’Empire. A cette période, la Constitution ottomane a été promulguée, et le premier Parlement turc a été élu
La transparence budgétaire, c’est possible ...
Auteur : Azeddine Akesbi, Mohamed Boussetta
L’accès à l’information et le contrôle social sont supposés participer au fonctionnement démocratique et fournir un certain pouvoir aux populations. Ils permettent également d’exercer les pressions requises pour assurer une plus grande efficacité dans l’utilisation des deniers publics et assurer une plus grande chance pour que les dysfonctionnements soient identifiés et corrigés.
Cette approche rejoint et consolide l’action des différents acteurs qui préconisent de combattre le gaspillage et la corruption par la réduction des pouvoirs discrétionnaires des responsables, la lutte contre l’opacité et la promotion de la transparence.
Globalement, l’enquête sur le budget ouvert 2008 indique que l’état de la transparence dans le monde est déplorable. Dans la plupart des pays enquêtés, le public n’a pas accès aux informations détaillées nécessaires pour participer au processus budgétaire et pour exiger du gouvernement qu’il rende des comptes. Ce manque de transparence encourage les dépenses inappropriées et la corruption ; il réduit en outre la redevabilité des décideurs politiques et économiques vis-à-vis des citoyens.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les résultats du budget ouvert reflètent la quantité d’informations budgétaires pertinentes et publiquement accessibles au niveau des huit documents budgétaires de base1. D’après les résultats de 2008, une catégorisation a été conçue en cinq groupes de pays.
Le premier groupe ayant un score compris entre 81 et 100 fournit des informations approfondies ;
Le second groupe (entre 61 et 80%) fournit des informations significatives;
Le troisième groupe (entre 41 et 60%) fournit quelques informations ;
Le quatrième groupe (entre 21 et 40 %) fournit des informations minimales ;
Enfin, les pays ayant un score qui se situe entre 0 et 20% fournissent peu ou pas d’informations au public et à leurs citoyens.
Les bons résultats de certains états comme l’Afrique du Sud, la Slovénie, le Sri Lanka, le Botswana, voire l’Egypte, démontrent que les pays en voie de développement peuvent être transparents si leurs gouvernements ont la volonté d’être ouverts et responsables devant leurs citoyens. Ainsi, l’Egypte a gagné 25 points passant de 18% à 43 % grâce essentiellement à la publication du projet du budget de l’Exécutif.
[photo manquante]
LES PERFORMANCES DU MAROC
Le classement du Maroc apparaît mauvais, aussi bien pour l’édition de 2006, puisqu’il s’est classé 53ème sur 59 pays avec une note de 19 sur 100, que pour l’édition 2008, durant laquelle il a occupé le 59° rang sur un total de 85 avec une note de 27 sur 100. Il fait toujours partie de l’avant dernier groupe de pays qui fournissent une information minimale à leurs citoyens, même si son score s’est quelque peu amélioré entre les deux années.
Notre pays est surtout pénalisé par le grand nombre de scores d (52) et de scores c (36), qui tirent vers le bas son classement et limitent la note obtenue. Les défaillances apparaissent particulièrement au niveau de l’absence d’un budget citoyen, de l’inexistence ou la non publication d’un véritable budget en milieu d’année, de l’absence d’un rapport d’audit, etc.
Le classement du Maroc s’explique aussi par d’autres facteurs comme le caractère global et agrégé des données budgétaires (recettes et dépenses), la non publication de statistiques pluriannuelles au niveau de la proposition budgétaire, le pouvoir d’amendement très limité des parlementaires – surtout avec l’utilisation abusive de l’article 51 –, l’importance des fonds secrets et extra budgétaires, le peu d’intérêt accordé à la loi de règlement, etc.
[photo manquante]
On peut souligner également que la question de l’absence d’une loi ou d’une législation qui garantit à ses citoyens l’accès à l’information se pose avec une grande acuité. Son adoption est de nature à contribuer à une amélioration significative de notre classement en favorisant la transparence budgétaire.
Quelques définitions
Transparence budgétaire : «Le fait de faire pleinement connaître, entemps opportun et de façon systématique l’ensemble des informations budgétaires» (référence de cette définition ?)
Pré budget : publié au plus tard un mois avant l’introduction de la proposition budgétaire, il doit formuler explicitement les objectifs de la politique économique et budgétaire à long terme et mettre la lumière sur le niveau total des recettes et dépenses, du déficit ou, de l’excèdent, et de la dette.
Budget citoyen : C’est un résumé simplifié du budget approuvé. Diffusé au travers des médias, il doit être accessible au plus large public. Rapport en milieu d’année : Il doit fournir une mise à jour complète de l’exécution du budget, notamment une prévision des résultats budgétaires pour l’année en cours et pour les deux années suivantes au minimum. Il doit également permettre de réexaminer les hypothèses économiques qui sous-tendent le budget.
Rapport d’audit : Publié par un organe indépendant, il rapporte annuellement les résultats au législatif et au public. Il doit contenir toutes les activités entreprises par l’Exécutif et sa publication doit se faire dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année budgétaire.
[photo manquante]
QUE FAIRE ?
En fait, des progrès significatifs pourraient être réalisés rapidement et à un coût nul ou faible. Entre 2006 et 2008, de nombreux gouvernements ont décidé de mettre à la disposition du public les informations existantes, pour une utilisation en interne, ou celles produites déjà pour les organismes internationaux, et de produire ou de compléter certaines informations budgétaires publiées (pluri annualité des recettes et des dépenses, accélération du règlement du budget, etc.).
[photo manquante]
Dans notre pays, des améliorations immédiates sont possibles :
Du score «d» vers «a» :
• Préparation et publication du pré budget et du rapport mi-annuel, voire même du budget citoyen ;
• Inclure dans la proposition budgétaire des estimations multi annuelles ;
• Mener et publier une analyse de sensibilité sur le budget ;
• Fournir dans la proposition budgétaire des données et statistiques au delà de l’année T-1 ;
• Initier une loi réglementant à temps et une loi relative à l’accès du public à l’information ;
• Consulter le Parlement et le public sur les priorités budgétaires ;
• Mettre à la disposition du public certaines informations disponibles en interne : distribution du poids de l’impôt, précision des conditions associées à l’assistance financière internationale.
Méthodologie de l’Open budget
L’étude openbudget (ou budget ouvert) est fondée sur un questionnaire préétabli et uniforme. Il est composé de 123 questions, dont 91 évaluent l’accès du public à l’information et forme l’index sur le budget ouvert. 32 autres concernent des questions liées à la participation publique aux débats budgétaires, ainsi qu’au renforcement de la supervision budgétaire.
Les questions sont soumises à une échelle de notation composée de quatre notes : a signifie que l’information est totale et disponible (100%) ; d correspond à l’absence ou à la non disponibilité de l’information (0%).
En fonction de ce qui est publié, la réponse peut être a (100%), b (66%), c (33%) ou d (0%). Cette échelle permet de calculer des scores pour chaque pays sur la base des réponses aux questions et ensuite leur classement.
L’indice sur le budget ouvert est la moyenne des réponses aux questions relatives à la mise à disposition de l’information pour le public.
Pour l’exercice 2008, il a été inclus la possibilité pour les gouvernements concernés de réagir aux documents et de présenter leurs remarques, mais très peu de pays ont eu recours à cette possibilité. Le Maroc n’a pas utilisé cette option, malgré les contacts faits dans ce sens par Transprency Maroc et par le Centre du Budget et des Priorités Politiques.
Des progrès sont possibles :
• Au-delà de l’accès aux documents de base, il faudrait améliorer la qualité et la pertinence de l’information disponible pour les citoyens (répartition de la charge fiscale, impact de certains grands projets, etc. ;
• Améliorer la participation des citoyens au processus budgétaire, notamment par l’organisation d’audiences publiques sur le budget, auxquelles seront associés les citoyens et les médias ;
• Développer l’indépendance de la Cour des comptes et renforcer ses moyens humains et financiers, tout en donnant des suites à ses rapports.
En résumé, l’enquête openbudget 2008 (comme celle de 2006) dans le cas du Maroc montre qu’il est difficile pour les citoyens de tenir le gouvernement pour responsable de la gestion des deniers publics. Le budget offre un minimum d’informations pertinentes et ne permet pas aux citoyens d’avoir une vision claire et compréhensive des finances publiques. De même, l’accès aux informations détaillées pour comprendre des projets spécifiques est très limité, voire inexistant.
[photo manquante]
Il est difficile de suivre la collecte des impôts, l’exécution des dépenses et des emprunts en cours d’année. Par ailleurs, les recommandations des audits sont peu suivies d’effet. Ce qui globalement ne permet pas de renforcer la reddition des comptes et de savoir correctement et efficacement comment le budget a été dépensé.
[photo manquante]
Le contrôle parlementaire est faible et peu efficace et la prédominance du pouvoir exécutif sur tout le processus budgétaire est écrasante. Il existe dans les faits de nombreux cas de fonds extrabudgétaires qui échappent à tout contrôle parlementaire, voire même à l’Exécutif et a fortiori aux citoyens : Fonds Hassan II, Projet Bouregreg, budget des Habous , Tanger Med, Fonds affectés aux structures sécuritaires (…), etc.
Autant de réformes à mener et d’actions à engager pour rendre transparente la gestion des finances publiques et améliorer notre classement dans l’indice international du budget ouvert. Ceci est d’autant plus important que le rôle du budget de l’Etat dans les domaines économique et social est fondamental.
La vie, pas la dette
Auteur : Damien Millet, Eric Toussaint
La dette ? «Un mécanisme très subtil de domination des peuples» par les grandes puissances et les entreprises transnationales, une atteinte à la souveraineté des Etats, clame le Comité pour l’annulation de la dette du Tiers-Monde (CADTM). Dans un tour d’horizon très détaillé des Etats européens nouvellement touchés par l’ampleur de ce phénomène bien connu depuis trente ans par les pays en développement, il en démonte les mécanismes économiques et politiques : responsabilité des banques privées, spéculation, privatisation des profits et socialisation des pertes, confusion entretenue entre dette extérieure publique et privée… Partout les mêmes atteintes aux droits sociaux, économiques et culturels des peuples. Le CADTM fustige la responsabilité des banquiers, des fonds de pension et du FMI qui, malgré son discrédit lié à sa politique dans le Sud, reprend, sous le couvert d’un discours fallacieusement présenté comme nouveau, les mêmes politiques. Pour le collectif d’économistes, la dette est le résultat des doctrines néolibérales, et non la cause. Développant la notion de «dette odieuse», donc illégitime, il donne l’exemple du Sud, qui, à l’instar de l’Equateur, a imposé un audit intégral de sa dette sous contrôle citoyen et a encadré dans sa Constitution la possibilité pour l’Etat de contracter des emprunts. Il réaffirme la supériorité de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et, s’appuyant sur le droit international public, énumère les motifs pour suspendre le paiement des dettes publiques. Contre les politiques d’austérité qui pèsent sur les plus pauvres et épargnent les plus riches, il invite à repenser les choix de société et de politique, dans le sens de la solidarité. Rappel salutaire…
Visages de Casa
Auteur : Michel Peraldi, Mohamed Tozy
Casablanca pousse par le milieu, les classes moyennes, et «se targue d’être devenue une métropole avant d’être une cité», expliquent Michel Peraldi et Mohamed Tozy. Les deux chercheurs du Centre Marocain des Sciences Sociales de l’université de Aïn Chok présentent les travaux de ceux qui ont participé à l’atelier d’anthropologie urbaine, dont l’ambition était d’aborder la ville par les récits de ceux qui la font au quotidien, en la parcourant, y travaillant, y souffrant, et l’apprenant. Car le propre de la métropole est bien de ne pas livrer les codes de ses usages, énigmatique pour le chercheur autant que pour ses usagers, y vivre c’est la décoder, avec sa subjectivité et ses réseaux... Chaque texte illustre une facette de cette ville, creuset de tout le Maroc, porte de l’Occident et laboratoire. On y lit des portraits de lieux (le Café de France, la gare routière Wlad Ziane), on y suit des ménagères, des vendeurs de rue, des cadres et des écrivains publics. Célibataires et divorcées y racontent leur quotidien. Chaque article adopte sa méthode et son style : récit, analyse…Passionnant.
Par : Kenza Sefrioui
Climat d'affaires: obstacles systémiques mais progrès théoriques
Auteur : Hammad Sqalli
Une politique monétaire et budgétaire stable, un taux de croissance plus soutenu et moins irrégulier, une plus grande diversification de l’économie : voici les principaux résultats, et non des moindres, des réformes engagées durant la période 2000-2009. De bonnes retombées qui ont par ailleurs conduit le Maroc a une reconnaissance internationale telle que l’atteste le statut avancé accordé par l’Union Européenne. Cependant, l’équilibre macro-économique du Maroc a été fragilisé par la crise économique et financière mondiale. Ne nous méprenons pas ! Le pays n’est pas un îlot qui poursuit la modernisation de ses entreprises et de ses institutions en marge de la mondialisation. Pour preuve, la baisse importante des exportations1 et des IDE2 apparaissent comme des indicateurs de fragilisation de l’économie. Cet équilibre est d’autant plus vulnérable que l’impact des réformes a été limité par des obstacles structurels et un déficit de mise en œuvre.
Ces deux grands constats ont notamment été mis en lumière dans le dernier rapport de l’OCDE sur l’évaluation du climat des affaires, publié en juin 2011. L’objectif de cette étude, initiée en 2009 à la demande du gouvernement marocain, à travers l’outil «Stratégie de Développement du Climat des Affaires» (SDCA) est double. D’une part, soutenir le gouvernement dans ses choix et réformes en évaluant l’existant et d’autre part, identifier, prioriser et mettre en œuvre les réformes ou actions politiques afférentes. Cet outil a été développé par le Programme MENA-OCDE et constitue un instrument visant à mobiliser l’investissement au service de la croissance et du développement durables. Il comporte à cet égard trois phases : l’analyse et l’évaluation du climat des affaires ; la définition des réformes prioritaires et projets associés ; et un soutien à la mise en œuvre de cette dernière. Il est à noter que ce rapport entérine la première de ces phases, donnant par là-même de très bons indicateurs de la situation actuelle. Soulignons également l’approche transverse et concertée de la SDCA.
En effet, douze dimensions - étudiées sur la base de deux cent quarante indicateurs - ont été l’objet de cette étude résultant d’un travail collectif entre le Programme MENA-OCDE et des acteurs privés, publics et non gouvernementaux. Cette action commune devrait ouvrir des perspectives de collaboration pour une approche plus intégrée des problématiques, c’est du moins ce qu’espèrent les analystes du Programme MENA-OCDE. Car les recommandations de ce rapport, outre celles afférentes à chacune des dimensions, mettent l’emphase sur des coordinations confuses qui entravent fondamentalement la bonne mise en œuvre des réformes.
En effet, l’exécution des différents plans ambitieux - comme le Pacte National pour l’Emergence Industrielle qui a été salué - souffre du manque de cohérence entre les différents plans sectoriels, ce qui rend difficile leur évaluation. Par ailleurs, le Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA) a le pouvoir de réaliser des réformes urgentes ce qui engendre une plus grande réactivité certes, mais encore une fois le SDCA note une vision trop court-termiste et de nature verticale. Autre lacune, celle du système institutionnel confus et peu adapté au monde des affaires, qui pêche par manque d’efficacité et de transparence, ainsi que par une structure trop hiérarchique. L’exemple le plus révélateur est celui du cas de la promotion des investissements dont trois organismes, placés chacun sous une tutelle particulière, ont la charge. Ainsi, la Commission des Investissements est directement placée sous la tutelle du Premier ministre ; l’Agence Marocaine de Développement des Investissements dépend elle du ministère du Commerce et de l’Industrie, quand les centres régionaux d’investissements (CRI) sont eux placés sous la houlette du ministère de l’Intérieur. Même constat pour les services horizontaux au niveau régional : la fonction du guichet unique pour les PME au sein des CRI n’est pas uniformisée selon les régions, tout comme les procédures, dans l’attente notamment de l’introduction d’un identifiant commun pour l’entreprise. Le cadre juridique n’est pas épargné, loin de là. Il est d’autant plus capital d’assainir ce cadre qu’il est le socle fondamental à tout projet économique. Rappelons-nous que l’Union européenne n’aurait pas harmonisé ses politiques commerciales sans un cadre juridique solide, de l’amont à l’aval. Au Maroc, les progrès demeurent sur le plan théorique, mais au niveau de l’exécution et de l’applicabilité, les obstacles systémiques tels que la lourdeur administrative et la corruption freinent cet élan. Les recommandations faites en ce sens portent sur une révision de la Charte des Investissements ; le gouvernement doit par ailleurs communiquer de façon plus transparente et intègre, ainsi que renforcer le système des incitations et des sanctions. Le défi de la réforme de la justice reste entier afin d’asseoir l’Etat de droit.
1 En dépit de l’accroissement du commerce extérieur passant de 25 à 77 milliards d’USD (Banque mondiale) pour la période 2002-2008, les exportations ont chuté de 13% en 2009 dont 57% sont imputés à la baisse de la demande mondiale et 27% à la facture énergétique
2 Les flux d’IDE vers le Maroc ont chuté en 2009 de 47% par rapport à 2008, soit 1,5% du PIB national, en cause, la dégradation du climat financier mondial qui a touché le tourisme et l’industrie. L’immobilier et le secteur bancaire ont mieux résisté aux chocs exogènes
Par : Hammad Sqalli
Les sirènes de la domination
Auteur : Kenza Sefrioui
Tout véritable rapport de domination comporte un minimum de volonté d’obéir», affirmait Max Weber. Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Centre d’études et de recherches internationales à Sciences Po, a pris au mot le sociologue allemand. Dans Anatomie politique de la domination, elle s’intéresse aux mécanismes d’exercice et de reproduction de la domination d’Etat.
Cette question centrale de la théorie politique et sociale est le plus souvent analysée sous l’angle de la violence. Or, pour l’auteure : «Aucun gouvernement, y compris le plus totalitaire […] ne repose exclusivement sur la violence». Plus que les mécanismes de coercition, elle étudie les «dispositifs et pratiques qui font de la domination une «douceur insidieuse», selon des modalités largement acceptées, voire recherchées et souvent légitimes, et non sur la dimension purement répressive de l’exercice du pouvoir, sur l’usage de la peur et de la violence».
Son approche est novatrice car comparatiste des situations autoritaires et totalitaires. Béatrice Hibou puise les éléments de sa démonstration dans l’histoire de l’Italie fasciste, du Portugal salazariste, de l’Allemagne nazie, de la RDA et de l’URSS, de la Tunisie, du Maroc ou encore de la Côte d’Ivoire.
La rhétorique des «douceurs insidieuses»
Dans une première partie, elle démonte les discours qui contribuent aux processus de légitimation de la domination autoritaire. L’aspiration des populations à vivre dans «la normalité» en est une composante essentielle. «La question de la normalité et de la conformité est avant tout une question de représentation. Représentation de la frontière - elle-même floue - entre conforme et non-conforme, entre normal et anormal ; représentation peut-être surtout de la dangerosité (ou non) de la non-conformité et de l’anormalité». Elle décortique le langage du politique, sa façon de produire une culture qui se diffuse dans l’ensemble des relations sociales, du travail jusque dans l’intimité, bref, l’idéologie, comme productrice de mythes et de fictions, et qui fonctionne comme «ressort subjectif de la légitimité». Elle montre notamment comment l’Etat autoritaire se présente toujours comme une réponse à des aspirations légitimes à la protection, à la sécurité et à la stabilité, quitte à inventer des dangers (l’islamisme, contre lequel le régime tunisien se posait en rempart). Béatrice Hibou remarque que «la sollicitude de l’Etat est indissociable de la dépendance qu’il crée». Elle analyse ainsi «la politique du ventre» ou l’économie du don et les «légitimités clientélistes», la tolérance des mouvements d’opposition dans un espace «normalisé». Elle se penche en particulier sur l’utilisation du «désir d’Etat», d’un Etat comme entité supra-politique au-dessus des partis, des conflits, des divisions et des intérêts particuliers, vers un Etat vecteur de consensus et d’unité», pour imposer la «violence du consensus», une «fiction» qui «apparaît comme une technologie centrale de pouvoir» : destiné à «persuader les citoyens que les orientations prises l’ont été par eux ou du moins avec leur consentement», le consensus «sert non pas tant à réaffirmer l’accord (des parties) prenantes qu’à clore toute délibération». De même, Béatrice Hibou souligne le rôle de la technocratie «dans l’exercice disciplinaire, voire totalitaire du pouvoir», en démontant la fiction d’une technocratie apolitique, citation de Gaston Bachelard à l’appui : «Les instruments ne sont que des théories matérialisées». L’expertise technocrate est en fait un «redéploiement négocié du contrôle et de la domination».
Mécanismes multiformes et empiriques
Dans la seconde partie du livre, Béatrice Hibou se penche sur la multiplicité des interactions entre gouvernants et gouvernés. En montrant l’importance des pratiques empiriques et individuelles, «la multiplicité des micro-décisions prises dans le temps», et l’infinité des intérêts contingents, elle fait voler en éclat les problématiques de l’intentionnalité, trop déterministes. Elle insiste sur les négociations et les arrangements circonstanciels qui rendent empiriques et ambivalents les mécanismes de domination. Le contrôle absolu est donc une illusion, le contrat social se réinvente sans cesse au gré des convergences d’intérêt. Ainsi, l’économie informelle est un «mode improvisé de domination» : «Le laisser-faire n’est pas un construit, mais il permet d’englober des choses que le pouvoir central ne peut contrôler». Et surtout, ces relations sont douées d’une importante plasticité qui peut «élargir les marges d’action» : si elles n’empêchent pas la domination, elles peuvent au moins «contribuer à la modeler et à l’altérer».
Cette approche des régimes autoritaires par le biais des mécanismes de persuasion, du consentement à la domination et des intérêts à obéir vise à «mieux faire apparaître la violence et la peur» : «leur insertion dans le quotidien - dans les dispositifs les plus insignifiants et les pratiques les plus banales - leur donne toute leur puissance». Par ailleurs, Béatrice Hibou met à jour des mécanismes qui existent aussi dans le cadre démocratique, et ses recherches permettent «de repenser en creux les démocraties néolibérales». Au final, ce livre, à l’analyse fine et richement documentée, propose tant une réflexion de fond sur les modalités d’exercice du pouvoir qu’un plaidoyer pour l’économie politique. «En analysant la vie quotidienne dans sa dynamique proprement économique et en considérant l’économique comme un lieu de pouvoir, un champ non autonome, un site d’analyse des rapports de force et des jeux de pouvoir», l’auteure rappelle une évidence trop souvent occultée : l’impossibilité de séparer les champs du politique, de l’économique et du social.
Par : Kenza Sefrioui
Quel rôle pour la société civile marocaine
Auteur : Michel Peraldi
La société civile marocaine connait depuis vingt ans un développement significatif, tant du point de vue du cadre légal - en voie d’assouplissement - que du strict point de vue numérique, avec l’enregistrement de plus de 38 000 associations1.
Par une approche participative inédite, le programme de recherche «Indice de la société civile» créé par l’ONG internationale CIVICUS2 et piloté sur le terrain marocain par l’Espace Associatif3, s’est appliqué à mettre en relief les principaux indicateurs sur l’état de santé de la société civile marocaine. Le travail d’enquête, réalisé en 2010 et mené sur un échantillon de 1297 personnes de la population nationale et 211 organisations de la société civile réparties sur l’ensemble du territoire, a donné lieu à la publication d’un rapport national mettant en relief la singularité de la situation marocaine4.
D’emblée, le rapport soulève deux éléments représentatifs du contexte marocain et qui jettent une lumière crue sur l’environnement social global (niveau d’éducation globale et conditions de vie) dans lequel opère la société civile5: le niveau excessivement élevé d’analphabétisme, et les écarts importants de richesse. La population enquêtée est analphabète à 41,5%, et 6% seulement ont un diplôme universitaire. Quant aux écarts de richesse, 40% de la population enquêtée vit avec moins de 3000 DH par mois et 13% vivent avec plus de 5000 DH.
Paradoxe s’il en est, mais néanmoins révélateur de la difficulté à définir la société civile et son rôle, l’activité de plaidoyer n’est globalement pas perçue comme un aspect fondamental du travail associatif, alors que par ailleurs une grande importance est accordée à la défense des droits dans les préoccupations de la population. Il semblerait donc que tout ce qui touche de près ou de loin à la politique est immédiatement frappé de discrédit par l’opinion publique. L’activisme social est à la fois mis en valeur et discrédité ou ignoré dès lors qu’il tente de franchir la frontière qui sépare la charité du plaidoyer politique. Tout se passe donc comme si les attentes des citoyens marocains à l’égard de la société civile se limitaient à un secteur associatif apolitique et non-partisan, capable cependant de construire du lien social, de contribuer au développement et de conduire de véritables politiques de changement.
En outre, si le bénévolat actif demeure un pilier fonctionnel de la société civile, il révèle en retour une faiblesse organisationnelle : le manque de professionnels salariés. Au Maroc, le constat repose sur un évident manque de moyen financier (50% des associations ne reçoivent aucune aide de l’Etat), ce qui engendre une carence du personnel qualifié, se répercutant sur les problèmes de gestion (déséquilibre budgétaire important du secteur associatif) et de gouvernance.
Autre problème soulevé par les enquêtes : l’implication de l’Etat marocain qui, par quelques discrets mais néanmoins efficaces effets de manches, parvient à contrôler la dynamique propre à la société civile et à lui soustraire une partie de son autonomie. Ainsi en est-il du cadre légal qui, bien qu’en voie d’assouplissement depuis vingt ans, n’empêche guère l’arbitraire politique et administratif de s’appliquer dans les faits, quand il n’est pas tout simplement question d’opacité notamment en matière de dispositifs d’utilité et de générosité publique. Corruption, favoritisme, clientélisme sont parties prenantes du jeu de pouvoir y compris dans la société civile (parfois coiffée à tort d’une auréole de pureté). Des maux qui, sans congédier pour autant la force contraignante des textes de loi, savent très bien négocier avec les défaillances et les angles morts du système.
Au final, la société civile n’est-elle vouée à exister réellement que dans le registre du plaidoyer pour appuyer les changements politiques ou peut-elle organiser le bien commun d’une manière autonome et «apolitique» sans risque d’instrumentalisation de la part des réels détenteurs des pouvoirs souverains ?
Sans répondre complètement à cette question, le rapport insiste en revanche sur un fait : la société civile n’est pas vouée à répondre à des questions de service public au niveau national, ni outillée pour prendre en charge des prestations de service de cet acabit. La meilleure option relevée restant la promotion des activités de plaidoyer pour la défense des droits, afin de se faire le porte-voix des citoyens, et surtout des exigences citoyennes.
Encadré:
L’«Indice de la Société Civile» (ISC) est un programme de recherche lancé par le réseau international CIVICUS en 1999, afin de combler l’écart qui existe entre la place grandissante de la société civile et les faibles connaissances afférentes à celle-ci. Le programme de l’ISC participe d’une mise en perspective globale et comparative (au niveau international), et d’un travail d’identification des acteurs et des attentes (par les enquêtes nationales). La combinaison des deux permettant d’entrevoir en premier lieu comment se définit la société civile mondiale à partir d’un socle de principes communs, en second lieu de repérer rapidement les obstacles et les défaillances propres à chaque cas national, et voir ensuite comment y remédier.
Par ailleurs, l’indice de la société civile se veut un programme d’évaluation participatif. «Participatif» dans le sens où l’évaluation ne se fait pas de manière unilatérale par des observateurs extérieurs, mais au contraire se construit et tire ses conclusions à partir d’un écheveau d’indices provenant à la fois d’un échantillon de la population, d’un échantillon d’organisations de la société civile (OSC), et enfin de l’avis d’experts.
La création du «diamant de la société civile» , diagramme combinant 5 critères fondamentaux, est le fruit de ces exigences que sont l’approche comparative et la visibilité immédiate. Les 5 critères retenus sont le niveau d’engagement citoyen, la qualité de l’organisation, la pratique des valeurs, la perception de l’impact et l’environnement général dans lequel prend place la société civile étudiée.
Les études nationales ne prennent pas en compte dans leurs rapports la dimension comparative. Elément essentiel du projet d’indice de la société civile, cette dimension comparative fera cependant l’objet d’un rapport ad hoc rassemblant toutes les données recueillies au niveau mondial.
1 Données recueillies auprès du Secrétariat Général du Gouvernement au moment de l’enquête
2 CIVICUS est une ONG internationale fondée en 1991 par le rapprochement de leaders mondiaux de la société civile désireux de mettre en commun leurs compétences afin d’établir des liens entre les différentes situations nationales, mettre en place des cadres d’analyses communs et des outils de renforcement de la société civile
3 L’Espace Associatif est une association marocaine fondée en 1996 visant au renforcement et à la promotion du mouvement associatif pour le développement démocratique
4 «Indice de la société civile», http://www.civicus.org/images/stories/csi/ csi_phase2/morocco%20acr.pdf
5 La pyramide de Maslow permet notamment d’évaluer la hiérarchie des besoins d’une population et donc sa capacité à dépasser les nécessités vitales pour se consacrer à d’autres besoins qui naissent hiérarchiquement par palier de satisfaction (besoin physiologique, de sécurité, d’appartenance, d’estime et d’accomplissement)
Par : Michel Peraldi
Nationalistes, Légitimistes mais optimistes
Auteur : Laetita Grotti
Ils ont entre seize et vingt-neuf ans et sont donc nés entre 1981 et 1994. Tous ont grandi et appris dans un monde déjà globalisé. D’où le réel intérêt de l’enquête conçue par la Fondation pour l’innovation politique, «2011, la jeunesse du monde» qui, en sondant les jeunesses de 25 pays, permet de mieux cerner les opinions et comportements de ces générations, tout en les comparant1 (cf. encadré méthodologique).
D’emblée, cette première génération marocaine globalisée semble vivre la mondialisation de manière assez ambivalente. En effet, alors qu’elle est considérée comme une opportunité par 91% des Chinois, 87% des Indiens et 81% des Brésiliens, les Marocains et les Turcs sont les seuls des pays en développement qui restent partagés sur la question. Mieux encore, 55% des Marocains (un des taux les plus élevés du panel) considèrent que ce qui se passe dans le monde a peu d’impact sur leur vie. Plus prosaïquement, un Marocain sur deux (47%) doute des bienfaits de la technologie.
Si l’enquête couvre de nombreux champs, nous avons souhaité mettre en lumière ce qui caractérise les jeunes Marocains de leurs homologues étrangers.
Primauté du religieux et affirmation de solidarités
Premier élément frappant quand on observe la jeunesse marocaine à la loupe, le plébiscite de la religion dans des proportions très supérieures aux autres pays. Elle apparaît ainsi comme le premier élément constitutif de l’identité (92%)2 et ce, sans comparaison avec les 24 autres pays. De même, alors que dans le reste du monde, la jeunesse reconnaît toujours plus d’importance à la dimension religieuse dans son identité qu’elle n’est disposée à y consacrer du temps, «comme si le lien avec la religion devait davantage à des logiques d’affiliation qu’à des logiques d’engagement» expliquent les auteurs de l’étude, au Maroc ils sont 90% à se déclarer prêts à y consacrer du temps. Dans le même ordre d’idées, la foi religieuse apparaît comme la première valeur à transmettre aux enfants (56%) alors que partout ailleurs, ce sont l’honnêteté et la responsabilité qui ressortent nettement en tête. Mais, et c’est peut-être là un élément à creuser, 51% des jeunes Marocains préfèrent une société fondée sur la science et la rationalité plutôt que sur les valeurs spirituelles. Certes, la majorité apparaît faible mais elle semble indiquer une volonté de dissocier la foi (personnelle) de l’espace public.
Y a-t-il un lien de cause à effet entre la primauté du religieux et l’altruisme dont font preuve les jeunes Marocains ? Toujours est-il qu’avec les Brésiliens, ils se caractérisent par une attention particulière portée aux autres. Avoir un travail utile à la société est important pour plus d’un jeune sur trois (38%). Aider ceux qui en ont besoin en leur consacrant du temps ou de l’argent suscite un fort engouement (92%). L’idée que les plus pauvres doivent pouvoir bénéficier de soins de santé gratuits y est unanimement partagée (93%). Alors que dans la plupart des pays, les jeunes sont peu disposés à payer pour les retraites des générations antérieures, les Marocains sont parmi les plus solidaires (76%). Une idée que l’on retrouve dans l’envie de bénéficier d’une forte protection sociale plutôt que de payer moins d’impôt. Plus frappant encore, 91% des Marocains estiment important pour eux de contribuer au bonheur des autres. Des chiffres qui expliquent peut-être le réel intérêt pour le militantisme associatif dont font preuve les jeunes Marocains (63%).
Famille, je vous aime
Partout les relations familiales sont jugées précieuses. L’importance des liens familiaux se retrouve dans la place que les jeunes accordent à la famille dans la construction de leur identité personnelle (88% au Maroc). Non seulement, ils accordent une grande importance à la famille mais les jeunes Marocains sont aussi satisfaits de leur propre famille (88%), au point qu’ils préfèrent passer du temps avec elle (93%) plutôt qu’avec leurs amis (81%). De même, la famille est partout perçue comme le fondement de la société. Parmi les différents aspects de l’existence, le fait de fonder une famille est celui qui correspond le plus à l’idée que les jeunes se font d’une vie satisfaisante, après le fait d’être en bonne santé. Au Maroc, fonder un foyer est un projet dans lequel se retrouvent 46% des Marocains. Par ailleurs, 86% accordent une grande importance à l’assentiment de leur famille dans le choix de leur conjoint.
Quand identité rime avec appartenances collectives
Avec la religion (92% des jeunes Marocains interrogés), la nationalité (87%) et le groupe ethnique (75%) constituent les trois piliers de l’identité marocaine. Ce lien avec la dimension collective se retrouve également avec force dans l’importance que ces jeunes accordent à l’humanité (88%) dans leur identité, loin devant la jeunesse européenne (79%).
L’importance de toutes ces appartenances collectives dans la construction de leur identité explique peut-être pour partie l’ambivalence des jeunes Marocains vis-à-vis de leur société. En effet, s’ils éprouvent avec une force particulière le sentiment d’appartenir à leur société (83%) - seuls les Indiens (89%), les Israéliens (84%), les Brésiliens (80%), les Chinois (79%) et les Mexicains (78%) se situent à un tel niveau - ils ne s’y sentent pas forcément à l’aise. Près d’un jeune Marocain sur deux (48%) dit avoir le sentiment que la société n’est pas tolérante avec des gens comme lui. Sur ce point, seule la jeunesse turque exprime un niveau de malaise plus élevé (53%).
Un malaise que l’on retrouve formulé dans l’intention des jeunes de quitter leur pays pour vivre ou s’installer à l’étranger. Avec la jeunesse roumaine, la jeunesse marocaine est celle qui affirme le plus fortement le projet d’émigrer. Invités à dire s’ils aimeraient vivre là où ils vivent actuellement, ailleurs dans leur pays ou à l’étranger, 29% des Marocains choisissent l’étranger. Un chiffre qui ne manque pas d’interroger, surtout s’il est corrélé aux 72% de jeunes Marocains reconnaissant n’avoir jamais quitté leur pays (un des plus forts taux du panel).
Des jeunes légitimistes
Au regard du Mouvement du 20 février, enclenché dans le sillage des soulèvements arabes et porteur de revendications prônant une monarchie parlementaire, ces résultats éclairent d’un jour nouveau le clivage qui semble s’opérer dans la société marocaine. Car nos jeunes se montrent fort légitimistes, bien plus que leurs aînés. Ce point pourrait d’ailleurs rassembler toutes les jeunesses du monde : elles se montrent légèrement moins défiantes que leurs aînés à l’égard des institutions politiques. Alors que Marocains et Israéliens affichent des taux record de confiance en leur gouvernement (60%), au Maroc, l’écart avec la génération précédente est particulièrement significatif (+ 15 points). Partout, l’armée recueille la confiance d’au moins 40% des jeunes. Au Maroc, ils sont 66% à lui faire confiance, 59% à faire confiance à la police et 60% à la justice. Avec 73%, les institutions religieuses apparaissent les plus crédibles. Quant aux médias, ils sont partout discrédités et la défiance s’exprime lourdement. Exception faite du Maroc où, avec 53%, nos médias sont ceux qui, dans le monde, inspirent le plus confiance à leurs concitoyens !
Une modernité peu assimilée
Loin devant les autres pays, les Marocains apparaissent comme les plus conservateurs en matière de sexualité hors mariage. Ils sont en effet 85% à ne pas la juger acceptable. De même, ils sont les plus nombreux à exprimer une gêne avec les personnes ayant une orientation sexuelle différente de la leur (40%). Comme ils sont, de loin, les plus rétifs à l’égalité des sexes puisque 50% d’entre eux n’ont pas retenu ce critère pour définir leur société idéale. Et que dire de cette société idéale où loi et ordre sont majoritairement revendiqués (65%), devant les libertés individuelles ?
Mais, et c’est peut-être là le plus rassurant, les jeunes Marocains restent non seulement optimistes vis-à-vis de leur avenir personnel (77%) mais aussi, et en opposition avec la plupart des pays du panel, vis-à-vis de celui de leur pays (67%).
Encadré méthodologique
L’enquête «2011, la jeunesse du monde3» a été conçue par la fondation pour l’innovation politique (Fondapol). Sa réalisation a été confiée au groupe TNS Opinion qui a interrogé 32 714 personnes sur la base d’échantillons nationaux comprenant 1000 individus âgés de 16 à 29 ans, ainsi qu’un échantillon supplémentaire de 300 individus âgés de 30 à 50 ans (destiné à permettre les comparaisons entre les jeunes générations et les plus âgées). Le questionnaire a été administré dans 25 pays et dans chacune des langues nationales, soit 20 langues au total. Il comportait 242 items. La collecte des données a été effectuée entre le 16 juin et le 22 juillet 2010. La méthode des quotas d’âge, de genre et de lieu d’habitation a été utilisée pour assurer une bonne représentativité des échantillons. Toutefois, l’enquête ayant été administrée via un questionnaire électronique, les échantillons des pays émergents sont davantage représentatifs des catégories les plus aisées de la population. Il est important de souligner que quelques questions jugées sensibles, portant sur les appartenances religieuses n’ont pas pu être posées au Maroc, «non pas en raison d’une quelconque censure mais d’un refus de répondre suffisamment massif pour nous conduire à retirer ces questions du questionnaire marocain», expliquent leurs auteurs
1 Il est important de préciser que sur l’ensemble des pays arabomusulmans, seuls la Turquie et le Maroc sont représentés dans le panel pour des raisons liées à la faisabilité de l’enquête
2 Les pourcentages cités représentent l’agrégation des réponses «tout à fait d’accord» et «plutôt d’accord»
3 www.fondapol.org/sondages/france-2011-la-jeunesse-du-monde