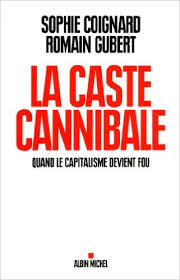
Défi au sens commun
Auteur : Sophie Coignard et Romain Gubert
Sophie Coignard et Romain Gubert dénoncent les dangers, pour l’intérêt général, de la collusion entre Etat et capitalisme débridé.
Le 10 octobre 2013, Richard Portes était invité à l’Université Paris-Dauphine. L’économiste enseignant à la London Business School avait réalisé pour le compte de la chambre de commerce islandaise un diagnostic sur son système financier, dont il chantait les louanges… à quelques mois de sa faillite : pas un mot sur cette désastreuse analyse. « Aujourd’hui, le conformisme admet que l’épisode le plus marquant de la vie professionnelle d’un économiste soit supprimé de sa biographie », relèvent les journalistes Sophie Coignard et Romain Gubert, scandalisés par cette « caste cannibale » dont même la crise de 2008 n’a pas réussi à briser l’omerta. « Il y a dans cette manière de fonctionner quelque chose qui rappelle le système stalinien, commentent les coauteurs de L’Oligarchie des incapables (Albin Michel, 2012). Une sorte de déni collectif qui se fracasse chaque jour davantage sur le mur de la réalité ». Leur enquête, en 23 chapitres centrés sur l’expérience française, dénonce les ravages produits par la collusion entre l’Etat et le capitalisme sans limite.
Les navettes incessantes entre le public et le privé tissent d’abord des liens dangereux entre décideurs politiques et banques d’affaires ou hedge funds : alors qu’hier, ces dernières « se contentaient de conseiller les Etats dans toutes leurs transactions ; demain, elles seront peuplées d’anciens ou de futurs ministres, chefs d’Etat et de gouvernement. L’équilibre des forces, désormais, penche de leur côté ». Des personnalités politiques (Sarkozy, Clinton, Aznar…) figurent désormais au catalogue du Washington Speakers Bureau, PME créée en 1979 en Virginie, offrant leurs services grassement rémunérés pour des conférences… Ces va-et-vient, renforcés par les effets de génération (promotions d’énarques et d’HEC) finissent par reléguer à l’arrière-plan sinon à occulter la notion d’intérêt général.
Entraves à l’action de l’Etat
Les auteurs déplorent la léthargie des pouvoirs publics face aux techniques (souvent légales) d’optimisation fiscale abondamment pratiquées par des entreprises comme Starbucks, Amazon, Google, Apple…, et notamment face à la domiciliation de sièges sociaux dans des paradis fiscaux, léthargie qui s’explique en partie « par le désir de chacun de chouchouter son paradis fiscal à lui ». Or cette question constitue un « enjeu économique majeur » pour les pays étranglés par la dette publique et noyés dans les déficits. De même, rien n’est fait pour lutter contre la pratique prédatrice mais légale du leverage buy out (LBO), qui consiste à racheter une entreprise sans rien dépenser et à la faire rembourser le crédit. « La liste des grands malades qui, sans l’intervention des prédateurs, seraient des entreprises tout à fait saines, est impressionnante ». Sophie Coignard et Romain Gubert s’indignent aussi que le Crédit impôt recherche soit employé à subventionner l’activité « trading haute fréquence » des banques françaises, « symptôme le plus évident de la dégénérescence du monde financier » puisqu’il s’agit d’un dispositif où des « supercalculateurs jouent les uns contre les autres en passant des centaines de milliers d’ordres de Bourse chaque seconde en fonction de logiciels qui n’ont plus aucun lien avec l’économie réelle »… Les auteurs doutent d’autre part de l’efficacité des Partenariats public-privé (PPP), qu’ils considèrent comment « l’antichambre de la corruption » quand il ne s’agit pas de pièges pour les Etats. Plus grave encore, l’idéologie du « fabless » ou de l’entreprise sans usine, prônée par Serge Tchuruk, ancien patron de Total et d’Alcatel, au bilan plus que contestable mais à la retraite dorée : « Plus d’usines, plus d’ouvriers, mais uniquement des sous-traitants auprès desquels on peut tirer sur les prix sans vergogne »… Ce système, qui dilue les responsabilités à l’infini, est abondamment pratiqué par Apple, qui ne produit pas un seul iPhone en direct – « Cela s’appelle le « branding », la gestion de marque, du marketing sans jamais mettre les mains dans le cambouis ») – mais sous-traite à Foxconn, son principal fournisseur, premier employeur de Chine avec 1,2 millions de salariés, qui réalise plus de 40 % de tous les produits électroniques dans le monde : dans son usine de Longhua, qui produit 150 000 iPhone par jour, 100 par minute, les salariés, logés dans des dortoirs, travaillent six jours sur sept pour un salaire qui ne leur permet pas d’acheter ce qu’ils fabriquent – « On est loin du modèle de Henry Ford ! » – et, face aux suicides à répétition, la direction a installé des filets pour les empêcher de sauter. Enfin, les auteurs dénoncent le « conflit d’intérêts permanent » à propos des agences de notations, puisque S&P, Moody’s et Fitch « sont payés directement par ceux qu’elles doivent juger », et le fait que la Banque centrale européenne ait renoncé à ses prérogatives en les hissant « au rang de quasi-régulateurs ».
Ce livre à charge dénonce le cynisme des tenants de cette doxa. Carlos Ghosn, numéro deux de Renault ? « Il emploie des mots neutres, dénués de tout caractère affectif pour décrire son action. Pas de charrette, pas de gestion par le stress, pas de gouvernement par la peur. Non, le propre du cannibale est de bien cacher son jeu » : des méthodes totalitaires, basées sur la paranoïa. Le désengagement de l’économie réelle, la disproportion entre la rémunération des patrons et celle des salariés, la captation des richesses[1], le soutien à des dictatures, l’absence de discrédit malgré les conséquences catastrophiques de diagnostics hasardeux ? Peu importe : « Qu’un grand patron fasse très bien ou très mal son travail, il touchera en moyenne plus de 3,5 millions d’euros chaque année. » Et quand Thomas Herdon, étudiant à l’Université du Massachusetts, montre que l’étude de Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff qui inspire les politiques d’austérité depuis 2010 est basée sur des calculs tronqués, il n’a pas été entendu… Face à cette idéologie à la peau dure, quid du capitalisme sans risque ? se demandent les auteurs ? « Erreur 404 » ! En dénonçant l’impunité et la versatilité de ceux qui se souviennent de l’utilité de l’Etat uniquement quand ils ont des problèmes, ils lancent un appel à la lucidité et au sens des responsabilités.
Par : Kenza Sefrioui
La caste cannibale, quand le capitalisme devient fou
Sophie Coignard et Romain Gubert
Albin Michel, 336 p., 20 €
[1] « Les 1 % « d’en haut » ont capté à eux seuls 95 % des gains liés à la reprise survenue entre 2009 et 2012. Durant la même période, leurs revenus ont augmenté de 31,4 %, contre 0,4 % en moyenne pour les 99 % restants, autrement dit la quasi-totalité de la population américaine », selon les économistes Thomas Piketty et Emmanuel Saez.

